Monsieur le Commandant (2011) de Romain Slocombe. NiL éditions, 2011.
 4
septembre 1942, Andigny, petite sous-préfecture de l’Eure. Paul-Jean Husson, écrivain renommé, membre de l’Académie Française, adresse au Sturmbannführer de la place une lettre dans laquelle,
après avoir longuement cherché à expliquer et justifier l’origine de son geste, il finit par livrer aux autorités d’occupation sa propre belle-fille, Ilse, qui est juive et dont il prétend
pourtant être follement amoureux.
4
septembre 1942, Andigny, petite sous-préfecture de l’Eure. Paul-Jean Husson, écrivain renommé, membre de l’Académie Française, adresse au Sturmbannführer de la place une lettre dans laquelle,
après avoir longuement cherché à expliquer et justifier l’origine de son geste, il finit par livrer aux autorités d’occupation sa propre belle-fille, Ilse, qui est juive et dont il prétend
pourtant être follement amoureux.
Un ouvrage troublant; d’abord en se présentant, par une note d’éditeur préalable, dans un cadre non fictionnel: la lettre qui
constitue l’essentiel de ce livre aurait été retrouvée accidentellement en 2006 par un réalisateur lors de la préparation d’un documentaire. Et tout du long de son livre parfaitement documenté,
Romain Slocombe, entremêlant malignement faits et individus réels avec des éléments et personnages nés de son imagination, maintient cet état d’incertitude, poussant plus d’une
fois le lecteur à interrompre le fil de sa lecture pour se livrer à de -vaines- recherches afin de tenter de découvrir qui pourrait se cacher derrière tel ou tel protagoniste (et, effet
collatéral, acquérant ainsi, au hasard de sa quête, quelques connaissances sur la période historique concernée -ce qui n’est déjà pas rien-). État d’incertitude qu’une fois la lettre terminée,
les perturbantes annexes (télégramme, note, interview...) qui achèvent cette œuvre viendront recouvrir d’une ultime couche de doutes.
Mais le principal trouble ressenti provient du "héros" rédacteur de cette lettre de dénonciation, Paul-Jean Husson: c’est un écrivain
alors au faîte de sa gloire, reconnu et célébré, partageant sa vie entre mondanités parisiennes et sa villa familiale normande d’Andigny (bourgade provinciale sur laquelle il semble régner -de
façon non explicite- comme investi des derniers relents d’un pouvoir féodal); c’est un homme au seuil de la vieillesse; c’est un catholique extrêmement de droite, conservateur et "banalement"
(pour l’époque) antisémite.
Débutant sa lettre par une espèce de genèse de son histoire familiale et des évènements historiques relativement récents, son regard
sur ce dernier aspect livre sans équivoque son tropisme politique: "1936 apporta à mon vieux pays gallo-romain l’humiliation d’être gouverné par un Juif. (...) Accourus du fond des ghettos
d’Orient à l’annonce de la victoire raciale, les nez courbes et les cheveux crépus se mirent à abonder singulièrement. (...) La France était devenue le dépotoir du monde." Positionnement
clair prédisposant à un accueil favorable à l’idéologie nationale-socialiste. Et le lecteur du XXIe siècle a donc tôt fait de voir en Husson un haïssable personnage.
Parallèlement, son histoire familiale tourne autour de l’arrivée en son sein de Ilse Wolffsohn, une jeune actrice allemande fiancée,
puis épouse de son fils Olivier. Du couple naît rapidement une petite Hermione. Cependant, dès leur première rencontre, Husson a ressenti un certain émoi à l’égard de la jeune fille, alors qu’il
se montrera par la suite pour le moins distant envers sa petite-fille (petit être qui fait de Husson un grand-père, statut qui, sans que cela soit exprimé, est un coup porté à l’image de soi d’un
individu qui semble se vouloir plutôt un homme à femmes).
Puis, tandis que l’Histoire bouillonne de l’autre côté du Rhin, l’histoire de la famille Husson vire au drame: d’abord par la noyade,
au cours d’une promenade en barque en compagnie de Ilse et Hermione, de Jeanne, sa fille chérie. Ensuite par le décès, suite à une tumeur au cerveau, de sa femme Marguerite. Enfin, choc extrême,
par la découverte de l’ascendance juive de sa belle-fille. Et par un raisonnement tortueux empreint de miasmes de catholicisme et d’antisémitisme, Husson fait de son fils Olivier, qui a "(...)
introduit un être impur au sein d’une honnête famille chrétienne (...)" et de la petite Hermione "les vrais coupables" de la perte de sa fille puis, imaginant un lien de cause à
effet psychosomatique, de celle de sa femme -exonérant ainsi étrangement Ilse-.
L’Histoire se précipitant, l’ambivalence du personnage de Husson va alors croître, tandis que les circonstances vont favoriser son
rapprochement avec Ilse: l’entrée en guerre contre l’Allemagne entraîne la mobilisation d’Olivier et donc la disparition, au moins pour un temps, du dernier membre de la famille s’interposant
entre lui et Ilse (et "libère", d’une certaine façon, Husson, qui retrouve ainsi une certaine jeunesse et donne dès lors libre cours à ses pensées érotiques vis-à-vis de la jeune fille); puis la
débâcle due à l’avancée rapide des troupes allemandes en territoire français les pousse à fuir ensemble sur les routes ce qui, bien que rien ne soit consommé, provoque des rapprochements
physiques. Finalement, l’occupation et l’avènement de Pétain (qui comble les vœux de l’ancien combattant de la guerre de 1914 qu’est Husson), tout en lui permettant de reprendre le cours normale
de sa vie, lui offre de surcroît une proximité avec le nouveau pouvoir en place cependant que le ralliement de son fils à De Gaulle et sa fuite vers Londres (fils qu’il renie alors) écarte
définitivement tout obstacle entre lui et Ilse.
Cette proximité avec le pouvoir pétainiste, Husson va en tirer parti: approuvant sans réserve les mesures anti-juives de plus en plus
terribles que prend le gouvernement (s’en faisant même le propagandiste dans la presse locale) mais s’inquiétant en même temps du sort de Ilse, il use de sa notoriété et de ses relations pour en
protéger sa belle-fille, la détenant ainsi -sans que cela soit ouvertement spécifié- en son pouvoir. Et il saura profiter de la détresse et de la solitude de la jeune fille.
Malgré cela, et là réside une des forces du livre de Slocombe, l’auteur va parvenir à nous faire croire en
l’authenticité de l’amour de Husson pour Ilse et réussir par-là même à rapprocher le lecteur de ce pourtant méprisable personnage: "Mon attention était monopolisée par Ilse Husson –par Ilse
Wolffsohn, par Ilse la Juive, par l’adorable Juive blonde à la voix charmeuse, au rire cristallin, aux lèvres fraîches, au corps élancé; par la bouleversante jeune mère aux yeux bleus languides,
dont l’évocation seule faisait bondir et battre mon cœur, au rythme d’une folle cavalcade. Il n’était plus en mon pouvoir d’arrêter ce processus. Mon attention paralysée ne me laissait plus
aucune liberté de mouvement. Me sauver, élargir le champ de ma conscience à autre chose qu’à Ilse, se révélait au-dessus de mes forces. Le pouvoir magique de la Juive, que j’aimais désormais
comme un fou, comme un vieux fou, dans un état bientôt paroxystique, était invulnérable à une quelconque remise en perspective."
Mais cette finalement plutôt confortable situation de Husson -qui, d’une certaine façon, se pose déjà en victime du "pouvoir
magique de la Juive"- ne durera pas, ébranlée par une succession d’évènements (reposant, d’un point de vue scénaristique, sur des coïncidences peut-être un rien forcées) qui, pour certains,
vont engendrer de la culpabilité ("Je m’étais damné moi-même.") puis en faire objectivement une victime (le rachetant de sa "faute"?) et le coincer dans un insoluble dilemme tandis que
d’autres vont sembler révéler la part d’humanité en lui.
La lettre adressée au Sturmbannführer H.Schöllenhammer sera la solution de Husson pour se sortir de ce guêpier. Et sur ce
point, Slocombe se montre particulièrement habile à nous faire partager les détours moraux de Husson pour se dédouaner à ses propres yeux d’un acte qui ménage tout à la fois son
catholicisme, son sens –perverti- de l’honneur et son aisance financière; et constitue pourtant une solution finale indéfendable.
In fine, à la lecture des éléments annexes de ce livre, le lecteur pourra être gagné par la tentation d’une dernière
perturbante réévaluation de Husson: toute sa narration rétrospective avant d’en arriver au but même de cette lettre, tout ce sentimentalisme, ces atermoiements n’étaient-ils en fait que le
romantique emballage de ses pulsions plus triviales et bien moins avouables à lui-même? Ou même simplement pure hypocrisie que le savoir-faire d’Husson l’écrivain a enveloppée/masquée sous les
embellissements de la littérature? Husson -Slocombe?- ne nous a-t-il finalement pas embobiné?
Ce livre écrit en toute logique dans un style classique (si tant est que cela signifie quelque chose) parvient à ce que le lecteur
s’identifie, partage les émotions et suive les dédales sinueux de l’esprit d’un haïssable héros; un haïssable héros qui, pourtant, n’est pas entièrement différent de chacun de nous. Un ouvrage
troublant. Une réussite.
D'autres chroniques chez action-suspense, chez Alexandre Clément et chez Black novel




 Turner a été flic; puis taulard; puis
thérapeute; puis... puis, fatigué du monde et surtout de lui-même, il s’est retiré s’installer pas très loin d’où il a passé son enfance, dans une baraque près d’un lac, aux alentours d’une
petite bourgade du Tennessee où il ne se passe habituellement pas grand chose; et où tout se sait très vite. Un jour, le shérif local débarque chez lui pour faire connaissance, mais d’abord et
avant tout pour faire appel à ses services: dans un lotissement inoccupé de la ville, un vagabond a été trouvé mort, attaché par des câbles à une espèce de treille, un pieu en pleine poitrine, et
à ses côtés une sacoche contenant des lettres interceptées qui étaient destinées au maire. Dépassé par ce meurtre, le shérif embauche Turner comme consultant. Turner va se laisser aller à
enquêter.
Turner a été flic; puis taulard; puis
thérapeute; puis... puis, fatigué du monde et surtout de lui-même, il s’est retiré s’installer pas très loin d’où il a passé son enfance, dans une baraque près d’un lac, aux alentours d’une
petite bourgade du Tennessee où il ne se passe habituellement pas grand chose; et où tout se sait très vite. Un jour, le shérif local débarque chez lui pour faire connaissance, mais d’abord et
avant tout pour faire appel à ses services: dans un lotissement inoccupé de la ville, un vagabond a été trouvé mort, attaché par des câbles à une espèce de treille, un pieu en pleine poitrine, et
à ses côtés une sacoche contenant des lettres interceptées qui étaient destinées au maire. Dépassé par ce meurtre, le shérif embauche Turner comme consultant. Turner va se laisser aller à
enquêter.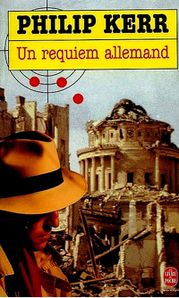 1947. Berlin en
ruines est toujours occupée par les alliés qui ont divisé la ville en quatre secteurs. Bernie Gunther, revenu de la guerre après avoir combattu sur le front de l’Est et été prisonnier dans un
camp russe, y vivote grâce à sa femme Kirsten, serveuse dans un bar réservé aux soldats américains, et a repris son activité de détective privé. Après avoir rapidement réglé une affaire qui
l’a conduit à l’Est de l’Allemagne et l’a contraint à tuer un soldat de l’Armée Rouge, il est contacté par le colonel Poroshin, des services secrets soviétiques. Celui-ci lui apprend qu’Emil
Becker, un ancien collègue supérieur direct de Bernie à la Kriminalpolizei puis officier SS pendant la guerre, qui se livre aujourd’hui à de la contrebande, a été arrêté à Vienne et inculpé pour
le meurtre d’un officier américain. Le colonel Poroshin se prétend persuadé qu’Emil Becker, à qui il dit devoir la vie, n’est pas l’assassin et propose à Bernie 5000 dollars pour qu’il mène sa
propre enquête sur ce crime. Bernie, accablé depuis qu’il a découvert que sa femme obtenait de quoi ravitailler son foyer en offrant plus que ses talents de serveuse aux soldats américains, finit
par accepter la proposition de Poroshin et part pour Vienne.
1947. Berlin en
ruines est toujours occupée par les alliés qui ont divisé la ville en quatre secteurs. Bernie Gunther, revenu de la guerre après avoir combattu sur le front de l’Est et été prisonnier dans un
camp russe, y vivote grâce à sa femme Kirsten, serveuse dans un bar réservé aux soldats américains, et a repris son activité de détective privé. Après avoir rapidement réglé une affaire qui
l’a conduit à l’Est de l’Allemagne et l’a contraint à tuer un soldat de l’Armée Rouge, il est contacté par le colonel Poroshin, des services secrets soviétiques. Celui-ci lui apprend qu’Emil
Becker, un ancien collègue supérieur direct de Bernie à la Kriminalpolizei puis officier SS pendant la guerre, qui se livre aujourd’hui à de la contrebande, a été arrêté à Vienne et inculpé pour
le meurtre d’un officier américain. Le colonel Poroshin se prétend persuadé qu’Emil Becker, à qui il dit devoir la vie, n’est pas l’assassin et propose à Bernie 5000 dollars pour qu’il mène sa
propre enquête sur ce crime. Bernie, accablé depuis qu’il a découvert que sa femme obtenait de quoi ravitailler son foyer en offrant plus que ses talents de serveuse aux soldats américains, finit
par accepter la proposition de Poroshin et part pour Vienne. quelques sarcastiques "viennoiseries" de la part de Bernie. Et au
final, si Un requiem allemand a conservé dans sa forme le charme de cette écriture hardboiled imagée qui prête à sourire ("Il avait un tel accent bavarois
que ses paroles semblaient surmontées d’un faux-col de mousse.") et qui redonne assez vite à Bernie ses traits archétypaux de privé tombeur de femmes et aux coups de poings faciles, et si
Philip Kerr a parfaitement su y restituer l’ambiance désolée et les conditions de vie pitoyables d’un pays dévasté par la guerre, cette enquête/immersion dans l’environnement
trouble, fallacieux et amoral des services secrets n’a toutefois pas cette tension, ce sentiment de constant danger qui flottait à la lecture des deux précédents volumes.
quelques sarcastiques "viennoiseries" de la part de Bernie. Et au
final, si Un requiem allemand a conservé dans sa forme le charme de cette écriture hardboiled imagée qui prête à sourire ("Il avait un tel accent bavarois
que ses paroles semblaient surmontées d’un faux-col de mousse.") et qui redonne assez vite à Bernie ses traits archétypaux de privé tombeur de femmes et aux coups de poings faciles, et si
Philip Kerr a parfaitement su y restituer l’ambiance désolée et les conditions de vie pitoyables d’un pays dévasté par la guerre, cette enquête/immersion dans l’environnement
trouble, fallacieux et amoral des services secrets n’a toutefois pas cette tension, ce sentiment de constant danger qui flottait à la lecture des deux précédents volumes. Felix, un quinquagénaire au
chômage, la vie à la dérive et le moral à plat, hérite du petit pavillon d’un vieil oncle décédé. A l’initiative de Simon, une rencontre de bar, braqueur en fin de parcours que les années de
prison ont plus fatigué qu’assagi, cherchant à monter un ultime coup, la maison devient la parfaite planque pour organiser un braquage: sise dans une petite rue d’une bourgade du Nord lessivée
par la crise économique, elle est sur le trajet quotidien d’un camion de transport de fonds. Avec Zamponi, un petit patron artisan amer, et Brandon, un jeune loubard des cités, toujours à fleur
de peau et les oreilles obstruées en permanence par des écouteurs braillant du rap, ils s’y installent, se faisant passer pour une équipe d’ouvriers en charge du ravalement, pour mettre au point
l’opération. Mais cette maison fut le lieu des vacances d’enfance de Félix et fait remonter par vagues à sa mémoire les souvenirs de ses jeunes années. Fouillant les archives de son oncle, il
tombe sur de vieilles coupures de journaux évoquant le sort d’émigrés polonais venus travailler dans les mines locales des décennies plus tôt et découvre les traces d’une Anna dont son oncle ne
lui avait jamais parlé et de qui il semble pourtant avoir été très proche. Félix se met à enquêter sur ce passé tandis qu’un soudain vent de revendications sociales des convoyeurs retarde au
dernier moment l'accomplissement du braquage, revendications aux conséquences inattendues sur toute la ville.
Felix, un quinquagénaire au
chômage, la vie à la dérive et le moral à plat, hérite du petit pavillon d’un vieil oncle décédé. A l’initiative de Simon, une rencontre de bar, braqueur en fin de parcours que les années de
prison ont plus fatigué qu’assagi, cherchant à monter un ultime coup, la maison devient la parfaite planque pour organiser un braquage: sise dans une petite rue d’une bourgade du Nord lessivée
par la crise économique, elle est sur le trajet quotidien d’un camion de transport de fonds. Avec Zamponi, un petit patron artisan amer, et Brandon, un jeune loubard des cités, toujours à fleur
de peau et les oreilles obstruées en permanence par des écouteurs braillant du rap, ils s’y installent, se faisant passer pour une équipe d’ouvriers en charge du ravalement, pour mettre au point
l’opération. Mais cette maison fut le lieu des vacances d’enfance de Félix et fait remonter par vagues à sa mémoire les souvenirs de ses jeunes années. Fouillant les archives de son oncle, il
tombe sur de vieilles coupures de journaux évoquant le sort d’émigrés polonais venus travailler dans les mines locales des décennies plus tôt et découvre les traces d’une Anna dont son oncle ne
lui avait jamais parlé et de qui il semble pourtant avoir été très proche. Félix se met à enquêter sur ce passé tandis qu’un soudain vent de revendications sociales des convoyeurs retarde au
dernier moment l'accomplissement du braquage, revendications aux conséquences inattendues sur toute la ville. 4
septembre 1942, Andigny, petite sous-préfecture de l’Eure. Paul-Jean Husson, écrivain renommé, membre de l’Académie Française, adresse au Sturmbannführer de la place une lettre dans laquelle,
après avoir longuement cherché à expliquer et justifier l’origine de son geste, il finit par livrer aux autorités d’occupation sa propre belle-fille, Ilse, qui est juive et dont il prétend
pourtant être follement amoureux.
4
septembre 1942, Andigny, petite sous-préfecture de l’Eure. Paul-Jean Husson, écrivain renommé, membre de l’Académie Française, adresse au Sturmbannführer de la place une lettre dans laquelle,
après avoir longuement cherché à expliquer et justifier l’origine de son geste, il finit par livrer aux autorités d’occupation sa propre belle-fille, Ilse, qui est juive et dont il prétend
pourtant être follement amoureux. Mitch sort de prison après trois années d’incarcération. A sa
sortie, il retrouve son ami Norton, qui lui a dégotté un logement. Norton recouvre les dettes contractées auprès d’un caïd local, Rob Gant, et propose à Mitch de jouer les gros bras lors de ses
tournées d'encaissement. Mitch accepte mais ne goûte guère à ce job brutal qui jette de pauvres gens à la rue. Un soir, sur le chemin du pub où ses potes ont organisé une fête pour célébrer son
retour, Mitch débarrasse une jeune femme, Sarah, de deux voyous. Quelques jours plus tard, Sarah rappelle Mitch au sujet d’un possible boulot pour sa tante, une emmerdeuse vivant seule avec
Jordan, son majordome, dans une vaste demeure. La vieille femme, Lilian Palmer, une ancienne gloire du théâtre qui prépare son grand retour sur les planches, reçoit Mitch et l’embauche comme
homme à tout faire. Mitch continue en parallèle à aider Norton, à la satisfaction de Gant, que son pote lui fait rencontrer. Mais Mitch se met à dos le caïd en refusant une proposition de ce
dernier. Il décide alors de prendre ses distances et s’installe, comme elle le souhaitait, chez la vieille actrice, où il finit par céder à ses charmes usés. Un soir, dans un pub, Mitch fait la
connaissance de Aisling, une jeune irlandaise dont il tombe amoureux. Mitch se retrouve alors emberlificoté entre Ainslig et l’actrice, entre son boulot d’homme à tout faire et ses anciens potes
qui lui proposent encore des coups, le tout en devant garder un œil sur sa sœur un peu fêlée Briony, tandis que Gant a lancé un contrat sur sa tête.
Mitch sort de prison après trois années d’incarcération. A sa
sortie, il retrouve son ami Norton, qui lui a dégotté un logement. Norton recouvre les dettes contractées auprès d’un caïd local, Rob Gant, et propose à Mitch de jouer les gros bras lors de ses
tournées d'encaissement. Mitch accepte mais ne goûte guère à ce job brutal qui jette de pauvres gens à la rue. Un soir, sur le chemin du pub où ses potes ont organisé une fête pour célébrer son
retour, Mitch débarrasse une jeune femme, Sarah, de deux voyous. Quelques jours plus tard, Sarah rappelle Mitch au sujet d’un possible boulot pour sa tante, une emmerdeuse vivant seule avec
Jordan, son majordome, dans une vaste demeure. La vieille femme, Lilian Palmer, une ancienne gloire du théâtre qui prépare son grand retour sur les planches, reçoit Mitch et l’embauche comme
homme à tout faire. Mitch continue en parallèle à aider Norton, à la satisfaction de Gant, que son pote lui fait rencontrer. Mais Mitch se met à dos le caïd en refusant une proposition de ce
dernier. Il décide alors de prendre ses distances et s’installe, comme elle le souhaitait, chez la vieille actrice, où il finit par céder à ses charmes usés. Un soir, dans un pub, Mitch fait la
connaissance de Aisling, une jeune irlandaise dont il tombe amoureux. Mitch se retrouve alors emberlificoté entre Ainslig et l’actrice, entre son boulot d’homme à tout faire et ses anciens potes
qui lui proposent encore des coups, le tout en devant garder un œil sur sa sœur un peu fêlée Briony, tandis que Gant a lancé un contrat sur sa tête. Linda, la fille du
commissaire Kurt Wallander, va avoir un enfant avec Hans, un jeune homme dont la famille appartient à la haute bourgeoisie suédoise. Le père de Hans, Håkan Von Ecke, donne une réception pour
fêter son soixante-quinzième anniversaire à laquelle est invité Wallander. Au cours de la soirée, Håkan, ancien officier de haut rang de l’état major de la marine suédoise, s’isole un moment avec
Wallander. Il lui raconte alors l’étrange histoire survenue une trentaine d’années auparavant d’un sous-marin russe repéré dans les eaux territoriales suédoises et à propos duquel, au moment où
il allait être capturé, contre toute attente, il reçut l’ordre, incompréhensible pour lui encore aujourd’hui, de le laisser filer. Tout en écoutant, Wallander note que son interlocuteur manifeste
des signes d’inquiétude. A quelques temps de là, Wallander, qui vit désormais à la campagne seul avec un chien, apprend l’inexplicable disparition de Håkan au cours de son jogging matinal. Bien
qu’en congé forcé suite à une bévue alors qu’il était ivre dans un restaurant, Wallander se met en devoir d’enquêter de son propre chef sur cette disparition. Puis Louise, la discrète femme de
Håkan, se volatilise à son tour.
Linda, la fille du
commissaire Kurt Wallander, va avoir un enfant avec Hans, un jeune homme dont la famille appartient à la haute bourgeoisie suédoise. Le père de Hans, Håkan Von Ecke, donne une réception pour
fêter son soixante-quinzième anniversaire à laquelle est invité Wallander. Au cours de la soirée, Håkan, ancien officier de haut rang de l’état major de la marine suédoise, s’isole un moment avec
Wallander. Il lui raconte alors l’étrange histoire survenue une trentaine d’années auparavant d’un sous-marin russe repéré dans les eaux territoriales suédoises et à propos duquel, au moment où
il allait être capturé, contre toute attente, il reçut l’ordre, incompréhensible pour lui encore aujourd’hui, de le laisser filer. Tout en écoutant, Wallander note que son interlocuteur manifeste
des signes d’inquiétude. A quelques temps de là, Wallander, qui vit désormais à la campagne seul avec un chien, apprend l’inexplicable disparition de Håkan au cours de son jogging matinal. Bien
qu’en congé forcé suite à une bévue alors qu’il était ivre dans un restaurant, Wallander se met en devoir d’enquêter de son propre chef sur cette disparition. Puis Louise, la discrète femme de
Håkan, se volatilise à son tour.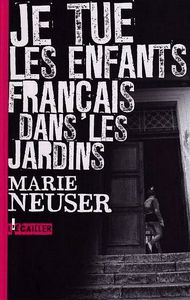 Lisa Genovesi, une jeune professeur d’italien dans un collège marseillais, vit particulièrement mal son quotidien professionnel fait "d’insultes et de crachats". Cette situation de
tension constante et de conflit ouvert, notamment avec certains élèves d’une classe de troisième, ne va faire que croître durant l’année scolaire, jusqu’à l’irréparable.
Lisa Genovesi, une jeune professeur d’italien dans un collège marseillais, vit particulièrement mal son quotidien professionnel fait "d’insultes et de crachats". Cette situation de
tension constante et de conflit ouvert, notamment avec certains élèves d’une classe de troisième, ne va faire que croître durant l’année scolaire, jusqu’à l’irréparable.