
Une bonne année 2012 littérairo-cinéphilo-rock'n'rollo-BDesque à tous ceux qui croient encore que la richesse est à l'intérieur du crâne plutôt que sur un compte en banque.

Une bonne année 2012 littérairo-cinéphilo-rock'n'rollo-BDesque à tous ceux qui croient encore que la richesse est à l'intérieur du crâne plutôt que sur un compte en banque.
L'âme du chasseur (The heart of the hunter – 2002) de Deon Meyer, traduit de l'anglais (sud-africain) par Estelle Roudet. Éditions du Seuil – 2005.
 Monica, la fille de Johnny Kleintjes, l’homme qui, ancien
dirigeant des services de renseignements de l’ANC pendant la lutte contre l’apartheid, avait été chargé, à la chute du régime ségrégationniste, d'intégrer les systèmes informatiques et bases de
données de l'ANC et de l’ancien gouvernement blanc, est contactée par un groupe d’extrémistes musulmans qui a enlevé son père. En échange de la vie de celui-ci, elle doit leur remettre le disque
dur sur lequel il avait copié des informations confidentielles concernant bon nombre de personnes haut placées aujourd’hui. Elle a soixante-douze heures pour se rendre à Lusaka, en Zambie. Dans
le coffre de son père, avec le disque dur, elle découvre un message indiquant le nom de quelqu'un à contacter en cas de problème: Thobela «P’tit» Mpayipheli. Monica parvient à joindre celui-ci,
un grand noir taciturne d'une quarantaine d'années qui travaille comme homme à tout faire dans un magasin de motos. Ce dernier accepte d’abandonner femme et enfant pour se charger d’apporter
lui-même le disque dur, car il considère avoir une dette d’honneur envers son vieil ami. Mais étant donné les secrets détenus par son père, le téléphone de Monica était en permanence sur écoute
et les services de renseignements décident d'intercepter le disque dur. Deux policiers se rendent alors à l’aéroport pour y arrêter Thobela. Ce dernier leur échappe et la façon dont il s’y prend
met la puce à l'oreille des services secrets qui commencent à enquêter sur le passé de cet homme apparemment tranquille. Et tandis que Thobela "emprunte" une moto à la boutique de son patron pour
prendre la route de la Zambie, les services secrets découvrent petit à petit que cet homme est loin d’avoir toujours été le quidam anodin qu'il semble être. La traque s'engage.
Monica, la fille de Johnny Kleintjes, l’homme qui, ancien
dirigeant des services de renseignements de l’ANC pendant la lutte contre l’apartheid, avait été chargé, à la chute du régime ségrégationniste, d'intégrer les systèmes informatiques et bases de
données de l'ANC et de l’ancien gouvernement blanc, est contactée par un groupe d’extrémistes musulmans qui a enlevé son père. En échange de la vie de celui-ci, elle doit leur remettre le disque
dur sur lequel il avait copié des informations confidentielles concernant bon nombre de personnes haut placées aujourd’hui. Elle a soixante-douze heures pour se rendre à Lusaka, en Zambie. Dans
le coffre de son père, avec le disque dur, elle découvre un message indiquant le nom de quelqu'un à contacter en cas de problème: Thobela «P’tit» Mpayipheli. Monica parvient à joindre celui-ci,
un grand noir taciturne d'une quarantaine d'années qui travaille comme homme à tout faire dans un magasin de motos. Ce dernier accepte d’abandonner femme et enfant pour se charger d’apporter
lui-même le disque dur, car il considère avoir une dette d’honneur envers son vieil ami. Mais étant donné les secrets détenus par son père, le téléphone de Monica était en permanence sur écoute
et les services de renseignements décident d'intercepter le disque dur. Deux policiers se rendent alors à l’aéroport pour y arrêter Thobela. Ce dernier leur échappe et la façon dont il s’y prend
met la puce à l'oreille des services secrets qui commencent à enquêter sur le passé de cet homme apparemment tranquille. Et tandis que Thobela "emprunte" une moto à la boutique de son patron pour
prendre la route de la Zambie, les services secrets découvrent petit à petit que cet homme est loin d’avoir toujours été le quidam anodin qu'il semble être. La traque s'engage.
L'ossature de ce roman est ultra classique: un homme entre en possession d’un Mac Guffin -ici un disque dur contenant des données confidentielles dont, jusqu'au bout, on ne sera pas sûr de la nature- et ne dispose que d’un temps limité pour se rendre dans un lieu de rendez-vous distant de plusieurs milliers de kilomètres tout en devant échapper à une organisation disposant de moyens disproportionnés qui cherche à l’intercepter. Sur la base de cette trame archi familière, voire éculée, le talent de Deon Meyer, c’est que ça marche une fois encore et l’on se prend très vite au jeu!
Et ce d’abord parce qu’il réussit à faire de figures proches du stéréotype des personnages vraisemblables -disons crédibles-, suffisamment en tout cas pour que l’on ne rechigne pas à adhérer à l’histoire.
Au premier rang de ceux-ci, le personnage principal, l’homme traqué, Thobela dont, dès le premier chapitre, on sait qu'avant de devenir ce quarantenaire à l’existence simple, il a eu un passé plus trouble: c'est un ancien soldat du MK (Umkhonto we Sizwe) -la branche armée de l'ANC- qui avait bénéficié d'une formation de haut niveau côté Est du Rideau de Fer pour devenir un tueur au service de régimes soutenant la lutte anti-apartheid. Mais si l’entraînement et les missions qu’il a accomplies en son temps en ont fait un homme peu commun, il est loin aujourd’hui d’être la redoutable machine à tuer qu’il fût, tant physiquement (les années commencent à lui peser) que moralement: il est pris dans des contradictions internes, entre la dette d’honneur contractée envers son ancien camarade de combat et son aspiration à une vie simple, sa volonté d’effacer cette partie létale à l’intérieur de lui-même qui demeure encore vivace. De plus, c’est un homme déçu qu’habite l’amertume de n’avoir pas recueilli, après la chute du régime d’apartheid, les fruits que ses années de lutte lui laissaient espérer.
La traque de Thobela est dirigée à partir de ses bureaux par Janina Mentz, une mère célibataire attentionnée, mais femme efficace, ambitieuse dans son travail et qui ne se satisfait pas des hautes responsabilités au sein des services secrets sud-africains auxquelles elle est pourtant parvenue; et les moyens tant technologiques qu’humains qu’elle met en œuvre sont évidemment sans commune mesure avec ceux dont se débrouille Thobela pour lui échapper.
Son bras armé, menant la chasse sur le terrain, c’est Tiger Mazibuko, un officier militaire à la tête d’une unité spéciale composée d’hommes proches de mercenaires et qui apparaît de prime abord dans la pure tradition du baroudeur avide d’action avant que le développement du récit ne révèle un personnage bien moins rustre.
Enfin, quatrième pôle de cette histoire, les médias, en la personne de la journaliste Allison Healy, une femme plantureuse mais solitaire qui aura incidemment vent de cette chasse à l’homme et dont l’intervention aura bien sûr des conséquences -parfois inattendues- sur son déroulement.
Ces quatre personnages, qui constituent les quatre points de vue principaux de la narration, Deon Meyer les entoure de figures secondaires auxquelles il parvient aussi à donner chair et personnalité propre et dont le rôle sera tout sauf négligeable.
En faisant donc alterner son histoire selon quatre points de vue, Deon Meyer permet une progression par à-coups,
sans temps mort. Et on lui sait alors gré, avec une telle construction éclatée, de s’être garder de tout effet de suspense facile, de tout ridicule cliffhanger de fin de chapitre auquel
d’autres auraient aisément pu se laisser aller. De façon plus générale, alors que tout dans ce récit le lui aurait permis, Deon Meyer évite la banalité du
spectaculaire.
En parallèle au pur déroulement de la traque de Thobela, le roman va petit à petit s’inscrire dans un contexte plus vaste, plus alambiqué, dans lequel on va plonger avec délice; un contexte fait d’espionnage international, avec agents infiltrés, agents doubles, taupes, manipulations, désinformation, pressions; fait de luttes d’influence et de domination dans les arcanes sombres du pouvoir; un contexte dans lequel s’affrontent diverses instances (gouvernement, services secrets, medias), chacune utilisant la fuite de Thobela à des fins propres. Le tout sans que jamais Deon Meyer n’oublie d’incarner ces différentes institutions, de les représenter à travers des personnages épais, élaborés, individualisés. Dès lors, cela lui permet de nous dire que même coincé au cœur d’un système, pris dans une machinerie qui voudrait n’en faire qu’un rouage, l’homme peut encore user de son libre-arbitre, faire des choix qui lui sont propres.
Plus globalement enfin, avec ce simple polar, Deon Meyer parle aussi de la réalité de l’Afrique du Sud, rappelant par exemple que derrière la figure quasi christique de Nelson Mandela se cachaient des acteurs plus discrets, loin de l’angélisme, qui ne répugnaient pas à des actions sombres, inavouables; ou laissant entrevoir la complexité de la situation post apartheid de ce pays où tous les comptes semblent encore loin d’être réglés tant au niveau de ceux qui en sont les nouveaux dirigeants qu’au niveau de ses habitants les plus modestes.
Au final, L’âme du chasseur est un roman intelligemment écrit, rondement mené, solidement personnifié et qui évite les pièges dans lesquels le lecteur aurait pu craindre de le voir tomber (y compris la fin); un roman qui titille notre esprit d’aventure tout en s’inscrivant dans un environnement plus large, proposant quelque éclairage sur le monde. Doit-on demander beaucoup plus à un -très- bon polar?
* Le titre de cette chronique est piqué à celui d’une chanson de Peter Hammill sur l’album The Future Now (Charisma Records -1978).
Le Havre (2011) de Aki Kaurismaki, avec André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Daroussin, Blondin Miguel, Elina Salo, Evelyne Didi, Quoc-Dung Nguyen, Pierre Etaix, Jean-Pierre Léaud, Roberto Piazza.
 Marcel Marx, ex écrivain sans succès ayant mené la vie de bohème à
Paris, est aujourd’hui cireur de chaussures ambulant au Havre. Il vivote honorablement avec sa femme Arletty et son chien Laïka dans une zone de la ville faite de petites cabanes accolées,
entre un petit bistrot fréquenté uniquement par de rares habitués et quelques minuscules commerces. Un midi, alors qu’il déjeune sur les marches du port, tandis qu’Arletty, gravement
malade, a dû être hospitalisée, Marcel tombe sur un gamin noir d’une dizaine d’années qui se cache dans l’eau, derrière une poutrelle. C’est un clandestin venu du Congo et recherché par la police
menée par l’inspecteur Monet. Marcel recueille l’enfant chez lui. Inébranlablement optimiste tant pour la santé de sa femme que pour l’avenir de l’enfant, il décide d’aider le gamin à passer à
Londres pour y retrouver sa mère.
Marcel Marx, ex écrivain sans succès ayant mené la vie de bohème à
Paris, est aujourd’hui cireur de chaussures ambulant au Havre. Il vivote honorablement avec sa femme Arletty et son chien Laïka dans une zone de la ville faite de petites cabanes accolées,
entre un petit bistrot fréquenté uniquement par de rares habitués et quelques minuscules commerces. Un midi, alors qu’il déjeune sur les marches du port, tandis qu’Arletty, gravement
malade, a dû être hospitalisée, Marcel tombe sur un gamin noir d’une dizaine d’années qui se cache dans l’eau, derrière une poutrelle. C’est un clandestin venu du Congo et recherché par la police
menée par l’inspecteur Monet. Marcel recueille l’enfant chez lui. Inébranlablement optimiste tant pour la santé de sa femme que pour l’avenir de l’enfant, il décide d’aider le gamin à passer à
Londres pour y retrouver sa mère.
Dans une note d’intention, Aki Kaurismaki déclare: "Le cinéma européen ne traite pas beaucoup de l’aggravation continue de la crise économique, politique et surtout morale causée par la question non résolue des réfugiés. Le sort réservé aux extracommunautaires qui tentent de rentrer dans l’Union Européenne est variable et souvent indigne. Je n’ai pas de réponse à ce problème, mais il m’a paru important d’aborder ce sujet dans un film qui, à tous égards, est irréaliste."
Irréaliste, l’univers de Kaurismaki l’est sans doute (ou peut-être évoque-t-il un réalisme poétique?) Mais le réalisme n’est pas indispensable -et même au contraire parfois insuffisant- pour rendre compte de la réalité.
La réalité, il suffit à Kaurismaki d’un court plan de transbordement d’un énorme container pour nous en faire éprouver, horrifiés, ce qu’il peut en être du destin des immigrés clandestins. La réalité, elle fait de brutales irruptions dans ce film, lorsque les forces dîtes de l’ordre investissent au petit matin l’humble logis de Marcel pour une fouille virile, lorsque Marcel se rend dans un centre de rétention qui a tout de la maison d’arrêt ou lorsque le poste de télé du bistrot qu’il fréquente assidûment diffuse les images d’actualité de l’évacuation musclée de la "jungle" de Calais. Devant ces dernières images, le simple geste du pouce sur la télécommande de la patronne dudit troquet pour éteindre le poste, sans un mot, en dit alors assez pour nous faire partager le sentiment ressenti par la petite communauté des habitués du lieu.
Face à cette réalité trop souvent brutale, Marcel Marx, sorte d’intellectuel dévoyé volontaire pour se rapprocher du peuple à
l’optimisme actif reçoit chaleur et humanité dans un petit coin du monde au look très années cinquante, oublié par la modernité; un petit village à l’intérieur de la ville où se
réchauffe -à coups de petits verres de vin- une communauté cosmopolite composée d’autres losers (selon les critères en vigueur de nos jours) tels son collègue vietnamien -immigré illégal
lui aussi-, une généreuse tenancière de bistrot à la clientèle plutôt démunie, une boulangère à l’échoppe minuscule plus souvent sur le pas de sa porte qu’en boutique, un astucieux épicier
d’origine maghrébine ou quelques vieux rockers décatis ayant abandonné leurs instruments pour la fraternité d’un zinc. C’est ce monde, où la presque pauvreté n’empêche en rien la dignité, que
Marcel retrouve quotidiennement, le soir, après avoir affronté celui hostile et froid du travail (voir le traitement qu’il subi de la part du boutiquier vendeurs de chaussures) dans un Le Havre
gris; un petit monde qui est un havre à l’intérieur du Havre, où solidarité, partage et assistance sont les valeurs  communes. Marcel Marx recueille chez lui l’enfant traqué naturellement, sans se poser aucune question, et lorsqu’il décidera de l’aider à passer à Londres, tous apporteront
volontiers leur contribution à la réussite de son entreprise sans qu’il soit besoin de se dire quoi que ce soit, comme si cette solidarité allait de soi, leur était intrinsèque, constitutive
(solidarité que l’on retrouvera dans le groupe de clandestins que Marcel rencontrera lors de son voyage à Calais, à la recherche de parents de l’enfant). Solidarité, partage, assistance, des
valeurs que la survenue de l’enfant au sein de la petite communauté de Marcel révèlent simplement, sans qu’il soit besoin du moindre discours, comme des valeurs de résistance.
communes. Marcel Marx recueille chez lui l’enfant traqué naturellement, sans se poser aucune question, et lorsqu’il décidera de l’aider à passer à Londres, tous apporteront
volontiers leur contribution à la réussite de son entreprise sans qu’il soit besoin de se dire quoi que ce soit, comme si cette solidarité allait de soi, leur était intrinsèque, constitutive
(solidarité que l’on retrouvera dans le groupe de clandestins que Marcel rencontrera lors de son voyage à Calais, à la recherche de parents de l’enfant). Solidarité, partage, assistance, des
valeurs que la survenue de l’enfant au sein de la petite communauté de Marcel révèlent simplement, sans qu’il soit besoin du moindre discours, comme des valeurs de résistance.
Ce propos simple, Kaurismaki le met en images avec un cinéma tendant à l’épure: une mise en scène essentiellement composée de plans fixes au cadrage élémentaire, un jeu des acteurs minimaliste, des dialogues semblant par instants plus récités que joués, parfois au bord de la naïveté (mais une naïveté qui parvient à nous dépouiller de notre carapace de cynisme et à laquelle on finit par adhérer, par vouloir y croire); un cinéma dégraissé pour montrer une humanité sans fard, à l’image des gros plans sur le visage ridé de Kati Outinen, un visage marqué, usé, raviné, qui ne l’empêche pourtant en rien d’être l’objet de l’amour de Marcel (à l’inverse des images "photoshopées " des magazines qui voudraient imposer à nos désirs des stéréotypes toujours plus impersonnels).
Dans Le Havre, on retrouve d’autres constantes du cinéma du finlandais: la prédominance des tons bleu ou
vert, quelques clins d’œil furtifs à ses propres films antérieurs (la table à repasser, le chien...), éléments constitutifs de l’univers "kaurismakien" à l’instar de son  humour elliptique et saugrenu (mais qui peut aussi, en une image -le gros plan sur la première page d’un journal- régler leur
sort aux médias), son goût assumé du mélodrame traité avec légèreté (oxymore ne pouvant s’appliquer qu’au cinéma de Kaurismaki) ou son vieux fond provocateur (ses
personnages, outre "l’incitation" tacite à la consommation d’alcool, sont des fumeurs en tous lieux et en toutes circonstances, y compris au mépris des injonctions légales) dont il saupoudre son
film.
humour elliptique et saugrenu (mais qui peut aussi, en une image -le gros plan sur la première page d’un journal- régler leur
sort aux médias), son goût assumé du mélodrame traité avec légèreté (oxymore ne pouvant s’appliquer qu’au cinéma de Kaurismaki) ou son vieux fond provocateur (ses
personnages, outre "l’incitation" tacite à la consommation d’alcool, sont des fumeurs en tous lieux et en toutes circonstances, y compris au mépris des injonctions légales) dont il saupoudre son
film.
Et son goût pour la musique populaire, avec une bande-son hétéroclite où se rencontrent Damia et le blues roots; et bien sûr le rock’n’roll. Aki Kaurismaki connaît parfaitement sa géographie du rock. Ainsi, au même titre qu’il avait honoré Joe Strummer dans son film londonien (J’ai engagé un tueur / I hired a contract killer - 1991), c’est de la présence de Little Bob dont il nous gratifie ici. (Kaurismaki: "Le Havre est le Memphis français et Little Bob est l’Elvis de ce royaume.") Et c’est un plaisir sans mélange de voir un P’tit Bob au visage de vieille pomme flétrie, accompagné de desperados vieillissants du rock, montrer sur scène une vigueur qu’on voudrait croire éternelle durant les quelques minutes de concert que nous offre Kaurismaki, images respectueuses de cette musique, à mille lieux du filmage aux plans ultra-courts "clipo-pubesques" que l’on nous inflige généralement. Et c’est du rock’n’roll que viendra le salut!
Avec ce film enfin, Kaurismaki le cinéphile rend aussi hommage aux -à certains- cinémas français: celui de Marcel Carné et plus généralement au cinéma d’avant-guerre, celui de Pierre Etaix (que l’on retrouve avec plaisir dans un second rôle), celui de la Nouvelle Vague (Jean-Pierre Léaud), de Melville.
Le Havre, à contre-courant des canons normalisateurs hollywoodiens, est finalement un "feel good
movie"; un de ces films dont on ressort avec une envie de croire à nouveau à d’improbables possibles. Ce film, exempt de tout blabla moralisateur, a pourtant quelque chose de l’acte de foi
en l’humain. Kaurismaki l’homme du nord bourru veut -une fois encore- nous faire croire (se faire croire?) en l’homme. Et il y parvient! Un film d’artisan qui  s’inscrit dignement dans cette internationale d’un cinéma continental prolétarien dans laquelle on aurait aussi envie d’inclure
Guédiguian (et de fait, l’intégration de l’acteur "gédiguianesque" Jean-Pierre Daroussin -ici en flic malin au visage fermé mais qui....- dans la famille
Kaurismaki paraît une évidence) ou Delépine & Kervern. Un film à l’optimisme désuet qui réchauffe le cœur.
s’inscrit dignement dans cette internationale d’un cinéma continental prolétarien dans laquelle on aurait aussi envie d’inclure
Guédiguian (et de fait, l’intégration de l’acteur "gédiguianesque" Jean-Pierre Daroussin -ici en flic malin au visage fermé mais qui....- dans la famille
Kaurismaki paraît une évidence) ou Delépine & Kervern. Un film à l’optimisme désuet qui réchauffe le cœur.
PS : Pour le cas où il serait nécessaire de le rappeler, tous les films d’Aki Kaurismaki sont à voir et à revoir!
Les voix de l'asphalte (Voices from the street – 1952-53), de Philip K. Dick, traduit de l'anglais (américain) par Nicolas Richard. Philip K. Dick Trust – 2007. Editions Le Cherche Midi – 2007.
 Stuart Hadley est
un jeune homme qui travaille comme vendeur dans un petit commerce d'appareils électroménagers. Marié, sa femme est sur le point d'accoucher. Alors qu’il semble tout avoir pour être heureux, sa
situation le rend profondément insatisfait, sans qu’il en connaisse la cause, et il tente d'évacuer sa frustration par une cuite hebdomadaire. Mais c’est loin de suffire à combler le manque qu’il
ressent et il reste habité par une violence enfouie. Un soir, il assiste à la conférence du révérend Beckheim, un évangéliste noir qu’il cherche ensuite à approcher. Et il rencontre Marsha
Frazier, une jeune femme rédactrice en chef d’une revue fasciste et se sent attiré par elle.
Stuart Hadley est
un jeune homme qui travaille comme vendeur dans un petit commerce d'appareils électroménagers. Marié, sa femme est sur le point d'accoucher. Alors qu’il semble tout avoir pour être heureux, sa
situation le rend profondément insatisfait, sans qu’il en connaisse la cause, et il tente d'évacuer sa frustration par une cuite hebdomadaire. Mais c’est loin de suffire à combler le manque qu’il
ressent et il reste habité par une violence enfouie. Un soir, il assiste à la conférence du révérend Beckheim, un évangéliste noir qu’il cherche ensuite à approcher. Et il rencontre Marsha
Frazier, une jeune femme rédactrice en chef d’une revue fasciste et se sent attiré par elle.
Ce roman -longtemps inédit- est l’un des tous premiers de Philip K Dick, alors qu’il avait encore des velléités de devenir un écrivain de littérature "blanche"; un roman dont la lecture, disons-le d’emblée, ne risque guère d’intéresser que les "ultra-aficionados" de l’auteur.
Car cette histoire de jeune homme perdu, amer, déprimé, inapte au bonheur version american way of life, en quête de quelque chose dont il ignore lui-même la nature, angoisse existentielle le poussant à se jeter dans les bras du premier sauveur venu mais rapidement déçu, qui remet sa vie -qu’il ressent comme une suite de fatalités- en cause et qui finira par une nuit de "pétage de plombs" est une œuvre de jeunesse qui, n'étant la renommée de l’auteur, serait peut-être -en l’état tout du moins- demeurer dans un tiroir. En effet, voilà un récit qui se traîne, extrêmement bavard, délayé, lent, où il ne se passe pas grand’chose et dérivant parfois vers des scènes dont on cherche le lien avec le cœur du propos. De plus, Dick ne parvient pas réellement à nous faire ressentir ni l’état de malaise de Stuart -c’est plus intellectuellement qu’émotionnellement qu’on le perçoit-, ni l’ambiance malsaine de la société plutôt formatée, apeurée, engluée dans les conflits guerriers (la guerre de Corée) et la guerre froide dans laquelle il s’inscrit. Le travail inabouti d’un débutant.
Ceci étant dit, le connaisseur de l’œuvre dickienne va quant même y grappiller ça et là des éléments à même d’éveiller son intérêt.
D’abord dans les transpositions romancées d’éléments biographiques de la propre vie de Dick: comme Stuart, il était, lors de la rédaction de ce livre, vendeur dans une petite boutique (ce qui lui permet de rendre compte la monotonie du quotidien); comme Stuart, Dick racontait qu’un jour -anecdote marquante et reflet des émotions d’une société à une époque- dans un cinéma, aux actualités, il avait vu des images de guerre montrant un soldat japonais en flammes après avoir été "dégommé" par un GI, véritable torche vivante suscitant rires et applaudissements dans la salle alors que lui en était extrêmement choqué; ou encore, dans les relations de Stuart avec sa sœur -dont il semble limite amoureux- transparaît quelque chose du ressenti particulièrement traumatisant chez Dick pour sa propre sœur jumelle morte quelques semaines après sa naissance.
Mais plus encore que ces points relativement secondaires, le "dickophile" trouvera dans ce livre les ébauches d’éléments qui réapparaîtront dans les romans postérieurs de l’auteur. Par exemple, plusieurs protagonistes sont ici des esquisses de figures qui deviendront quasi archétypales dans l’œuvre de Dick: le héros modeste employé pris au cœur d’une situation qui le dépasse ou le patron républicain-paternaliste-humaniste d’une petite entreprise; ou encore le prédicateur charismatique, figure -décevante- du Bien, ou son pendant néfaste, personnage fascisant incapable d’empathie (notion centrale chez Dick). Il pourra même y repérer des indices de l’attirance de Dick pour la SF (la description faite par le révérend Beckheim, lors de sa conférence, des aptitudes des prophètes faisant largement penser à ce qui sera plus tard le pouvoir des "pré-cogs") ou la religion; ou discerner dans la situation d’isolement, au bord de la paranoïa, de Stuart lorsqu’il aura totalement disjoncté un brouillon de ce qui sera celle -plus dramatique- de Jason Taverner dans Coulez mes larmes, dit le policier.
Au final la lecture des Voix de l’asphalte présente essentiellement un intérêt historique pour le dévot "dickolâtre" (dont j’avoue être...). Pour les autres, ignorants de l’œuvre du Maître...
Gros plan du macchabée, suivi de Hélène en danger (1949) de Léo Malet. Editions S.E.P.E. - 1949; Fleuve Noir -1985 ; 10/18 - 1989.
 Gros plan du
macchabée: Un acteur célèbre, sentant sa vie menacée, a engagé Nestor Burma, jeune détective privé débutant, pour lui servir de garde du corps durant le tournage d’un film en studio. De
retour dans sa loge après le filmage d’une scène, l’acteur s’écroule mort, empoisonné. Burma se lance alors dans la recherche de l’assassin, ce dernier se trouvant obligatoirement encore dans les
studios. Il découvre vite que l’acteur, homme à femmes sans scrupule, était détesté de beaucoup et que nombreux sont ceux ayant des motifs pour commettre ce crime.
Gros plan du
macchabée: Un acteur célèbre, sentant sa vie menacée, a engagé Nestor Burma, jeune détective privé débutant, pour lui servir de garde du corps durant le tournage d’un film en studio. De
retour dans sa loge après le filmage d’une scène, l’acteur s’écroule mort, empoisonné. Burma se lance alors dans la recherche de l’assassin, ce dernier se trouvant obligatoirement encore dans les
studios. Il découvre vite que l’acteur, homme à femmes sans scrupule, était détesté de beaucoup et que nombreux sont ceux ayant des motifs pour commettre ce crime.
Hélène en danger: Paris 1944. Hélène, la secrétaire de Nestor Burma, est arrêtée par la Gestapo, une lettre anonyme de dénonciation envoyée à l’occupant la désignant comme résistante. Faisant jouer des relations auprès de la Propagandastaffel, Burma parvient à la faire libérer. Une semaine plus tard, un homme se rend à l’agence Fiat Lux de Burma, mais c’est pour y mourir juste devant le bureau d’Hélène sans avoir eu le temps de dire un mot. L’homme a été empoisonné. Burma décide alors d’enquêter sur ce meurtre et comprend petit à petit qu’il n’est peut-être pas sans lien avec l’arrestation d’Hélène.
Il s’agit-là de deux parmi les premières enquêtes du fameux détective créé par Léo Malet.
Du point de vue purement polar, l’amateur reste un peu sur sa faim. La première enquête, un pur whodunit en lieu clos, assez "agatha christien" dans sa conception, avec son lot de fausses pistes, de personnages suspectés puis innocentés avant d’aboutir à la découverte du véritable assassin, donne une impression d’exercice de style, pas désagréable -Malet ne donnant heureusement pas dans le coup de théâtre facile- mais n’impliquant guère le lecteur. A noter tout de même que Malet semble avoir eu une bonne connaissance des plateaux de cinéma d’avant-guerre. La seconde enquête, elle aussi rondement menée, vaut surtout par son ambiance "Occupation", rendue notamment par les passages portant sur les restrictions que subit le héros (tabac et alcool en particulier) et la visite d’un lieu où se côtoient "en bonne intelligence" occupants et occupés.
C’est extrêmement bavard, les dialogues constituant la majeure partie de ces textes au point que les explications finales que donne Burma peuvent s’étaler sur plusieurs pages. De plus, les personnages secondaires tendent à être brossés à gros traits.
Mais cette lecture n’est pas sans plaisir. D’abord du fait du personnage de Nestor Burma: Léo Malet a créé un héros qui ne force pas la sympathie, gros buveur vantard, limite arrogant, sûr de lui, pas très loin du pastiche version "intello-populo" du détective privé à l'américaine. Ensuite, on pourra parfois sourire devant le style d’écriture de Malet, style qui a quelque chose de paradoxal: élaboré, avec quelques fois de longues phrases à la structure assez complexe, enchâssée, à l’impeccable construction grammaticale et syntaxique, mais où se mêlent un vocabulaire recherché, riche, et un argot le plus trivial. En outre, le texte de Malet donne de temps à autre une impression d’autodérision, un peu comme si, en filigrane, l'auteur ricanait par moments de sa propre écriture, s’en amusait et adressait un rapide clin d’œil au lecteur pour lui signifier la bonne distance à prendre par rapport au récit. Ainsi, lors d’un dialogue entre Burma et Hélène:
"(...) Bon sang, je n’ai pas de tabac et vous me laissez m’embarquer dans de pareilles phrases !
- Elles sont pourtant de qualité, même formulées à jeun, je veux dire sans l’aide de la fumée, sourit-elle, moqueuse. "Desiderata" et "télépathie", deux mots comme ça coup sur coup, vous vous rendez compte ! »»
En fin de compte, cet ouvrage de Malet n’a pas les qualités des œuvres de Simenon ou de Boileau & Narcejac. Mais il s’agit toutefois d’une vraie littérature populaire qui ne se fiche pas du lecteur, offrant une lecture plaisante, avec une écriture travaillée relativement originale, et qui suscite plutôt la sympathie.
Ville noire ville blanche (Freedomland – 1998), de Richard Price, traduit de l’anglais (américain) par Jacques Martinache; Presses de la Cité – 1998; 10/18 - 2002
 Une jeune femme blanche, semblant
en état de choc, les mains ensanglantées, traverse à pied Armstrong, la cité à population essentiellement noire située à la limite des villes de Dempsey et de Gannon, pour se rendre à l’hôpital
le plus proche. Arrivée aux urgences, elle déclare avoir été victime d'un car jacking. Lorenzo Council, un vieux flic noir originaire d’Armstrong, vient interroger la jeune fille. Celle-ci,
Brenda Martin, se montre d’abord rétive mais, patient, Council parvient à la faire parler: travaillant à Armstrong pour le Centre d'Études, un programme de soutien scolaire installé dans le
sous-sol d’un des bâtiments de la cité, elle y était retournée en voiture en début de soirée, pensant y avoir oublié ses lunettes. Cherchant ensuite un raccourci pour sortir de la cité, elle
s'était perdue. Lors d'une manœuvre, elle avait été abordée par un individu noir qui l'avait jetée hors de son véhicule et était parti avec. Council sent que la jeune fille ne lui dit pas tout.
Et en effet, elle finit par livrer que sur le siège arrière de la voiture volée dormait son fils de quatre ans, Cody. Council déclenche alors une vaste opération de recherche puis prévient
personnellement le frère de Brenda, Danny, qui lui aussi est flic, à Gannon. Les forces de l’ordre des deux villes investissent Armstrong, armés de vieux mandats non exécutés, mettant la cité
sous contrôle. A l’écoute permanente des communications radio de la police, les journalistes envahissent à leur tour Armstrong, parmi lesquels Jesse Haus, une jeune freelance qui a grandi dans
cette cité. Connaissant Council, elle réussit à approcher Brenda. Pendant ce temps, Armstrong, sous pression, commence à entrer en ébullition. Council, suspicieux, est quant à lui persuadé que
quelque chose ne colle pas dans l'histoire de Brenda.
Une jeune femme blanche, semblant
en état de choc, les mains ensanglantées, traverse à pied Armstrong, la cité à population essentiellement noire située à la limite des villes de Dempsey et de Gannon, pour se rendre à l’hôpital
le plus proche. Arrivée aux urgences, elle déclare avoir été victime d'un car jacking. Lorenzo Council, un vieux flic noir originaire d’Armstrong, vient interroger la jeune fille. Celle-ci,
Brenda Martin, se montre d’abord rétive mais, patient, Council parvient à la faire parler: travaillant à Armstrong pour le Centre d'Études, un programme de soutien scolaire installé dans le
sous-sol d’un des bâtiments de la cité, elle y était retournée en voiture en début de soirée, pensant y avoir oublié ses lunettes. Cherchant ensuite un raccourci pour sortir de la cité, elle
s'était perdue. Lors d'une manœuvre, elle avait été abordée par un individu noir qui l'avait jetée hors de son véhicule et était parti avec. Council sent que la jeune fille ne lui dit pas tout.
Et en effet, elle finit par livrer que sur le siège arrière de la voiture volée dormait son fils de quatre ans, Cody. Council déclenche alors une vaste opération de recherche puis prévient
personnellement le frère de Brenda, Danny, qui lui aussi est flic, à Gannon. Les forces de l’ordre des deux villes investissent Armstrong, armés de vieux mandats non exécutés, mettant la cité
sous contrôle. A l’écoute permanente des communications radio de la police, les journalistes envahissent à leur tour Armstrong, parmi lesquels Jesse Haus, une jeune freelance qui a grandi dans
cette cité. Connaissant Council, elle réussit à approcher Brenda. Pendant ce temps, Armstrong, sous pression, commence à entrer en ébullition. Council, suspicieux, est quant à lui persuadé que
quelque chose ne colle pas dans l'histoire de Brenda.
Dans ce roman, il y a un délit, une victime, des flics, une enquête, des suspects (il y a même écrit "domaine policier" sur la couverture de l'édition de poche). Pour autant, on n’a nullement affaire ici à un polar. Le fait divers d'origine -le vol de la voiture et la disparition de l'enfant- n'est en effet qu’un prétexte/catalyseur pour révéler au grand jour un état de tension lourde préexistant entre la cité de Armstrong et les villes qui la cernent.
Armstrong, c’est un semi ghetto coincé entre Dempsey et Gannon-la-blanche: "Chaque fois qu'il passait la frontière, Lorenzo était frappé par le changement abrupt de paysage, un simple feu rouge le transportant instantanément d'un monde de magasins abandonnés et de cités au bout du rouleau à un univers de façades en aluminium et de boutiques. Ce qui ne manquait jamais de l'énerver, à Gannon, c'était les agences de voyage: au moins deux par pâté de maisons, jamais très grandes, et offrant toutes les réductions habituelles pour la Floride, l'Italie et divers ports de plaisance des Caraïbes. Au contraire des rares agences de Armstrong, ou de D-Town, qui proposaient des vols pour la république Dominicaine, Porto-Rico, la Jamaïque et le Guyana. Lorenzo voyait dans ces destinations une différence fondamentale entre les communautés: à Gannon, quand on prenait l'avion, c'était le plus souvent pour partir en vacances; à D-Town, c'était pour rentrer au pays."
En se saisissant de ce qui arrive à Brenda Martin comme d’une opportunité pour "s’attaquer" à Armstrong, la police va exacerber la colère sous-jacente de ses habitants qui finira par éclater.
Cette montée en tension, Richard Price va la faire vivre au lecteur à travers trois principaux personnages: D’abord Lorenzo Council, le flic premier en charge de cette affaire. Ce vieux black au passé de délinquant a grandi dans Armstrong et en connaît bien les résidents. Paternaliste (tout le monde l’appelle "big daddy"), posé, réfléchi, ne se laissant pas aller à ses impulsions. Mais d’emblée, il est placé au cœur d’une ambiguïté: à la fois garant du maintien de l’ordre dans Armstrong, prévenant des débordements quotidiens, mais aussi lié personnellement, intimement à ce lieu et à ses habitants, partie prenante de cette communauté. Si cette situation "le cul entre deux chaises" lui permet généralement de jouer les tampons modérateurs, d’être -plus ou moins à son insu- une sorte de soupape de sécurité contenant Armstrong dans les limites du tolérable, l’ampleur que prendra l’affaire Brenda Martin va le dépasser, le déborder et se colorer d’une teneur sociale qui mettra à mal sa neutralité et l’obligera -un temps- à choisir son camp.
L’ambiguïté, elle est aussi présente dans le personnage de Jesse Haus, la jeune journaliste freelance. Cette fille de militants communistes parmi les derniers blancs à être restés vivre dans Armstrong, bien qu’étant parvenue à s’extraire de la cité, y reste fondamentalement attachée. Ambitieuse et mal dans sa peau, au contact de Brenda, l’empathie qu’elle va éprouver pour la jeune fille l’amènera elle aussi à se remettre en cause.
Tout au long du roman, ces deux-là tâcheront de ne pas lâcher Brenda (au propre comme au figuré).
Brenda Martin, une fille-mère à la jeunesse paumée, rebelle contre sa famille, au passé erratique (elle fut un temps membre d’une
secte new age), elle aussi tiraillée par des forces contradictoires que sont son origine sociale -une famille blanche aisée à la limite du racisme qui l’a rejetée- et ses sentiments, ses
positions plus libérales (au sens américain du terme), bouffée de culpabilité. Vite emportée, balayée, submergée par la tempête qu’elle a déclenchée, de plus en plus mutique, elle se laissera
trimballer de reconstitutions en lieux de repos, paniquée au coeur du maelström, se protégeant/se réfugiant dès qu’elle le peut sous les écouteurs de son casque à l’écoute de musique
black.
Car autour de ces trois-là, l’agression dont Brenda déclare avoir été victime a suscité des réactions, des interventions qui vont engendrer une tornade dans Armstrong:
Il y aura d’abord celle des flics, dont ceux, blancs, plus ou moins ouvertement racistes, de Gannon qui vont mettre Armstrong sous blocus, arrêtant, contrôlant tout le monde, pénétrant les domiciles, interdisant toute sortie de la cité. Parmi eux, Danny, le frère de Brenda, qui n’éprouve aucune affection pour sa sœur et dont l’apparition façon "cow-boy" laisse à penser qu’il se conforme plutôt à un rôle qu’il se serait lui-même attribué (on doute même qu’il éprouve un sentiment pour son neveu).
Il y aura les journalistes, omniprésents, caméras à l’affût, mi-armée d’occupation, mi-meute de chiens de chasse; ou maladie: "(...) le lendemain, le débarquement médiatique avait de nouveau multiplié ses métastases."
Il y aura encore les "Amis de Kent", association privée spécialisée dans la recherche des enfants disparus, avec à leur tête l’incroyable figure de Karen Collucci; un groupement lui aussi empreint d’équivoque qui se livrera à un ahurissant show à l’américaine/coup de pub avant d’entreprendre ses recherches, mais hyper organisé -quasi paramilitaire-, compétent, efficace; mais aussi capable d’user de méthodes tenant de la torture psychologique et qui pourtant aboutiront à la vérité.
Il y aura également les organisations militantes de la cause noire avec à leur tête des pasteurs qui viendront haranguer les habitants d’Armstrong, mettant en lumière le racisme à l’origine de la situation de la cité ("que personne n’avouait appeler Darktown"), mais prêts à tout pour faire entendre leurs revendications, défenseurs d’une cause juste utilisant et canalisant la colère des habitants de la cité pour leurs propres fins, quelles qu’en puissent être les conséquences. Ainsi, à propos de la marche de protestation qu’ils veulent organiser:
"-Pourquoi il faut absolument que ce soit ce soir? demanda Council (…)
-(...) Parce que ce sera pire ce soir qu'hier. Vous savez bien que cette fois la police ne restera pas l'arme au pied. En plus, il y aura toutes ces caméras, tous ces reporters. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud.
- Pendant qu'il est chaud, marmonna Council qui commençait à avoir les boules. Et si quelqu'un est blessé? Un jeune...
- Il sera blessé devant les caméras."
Enfin, il y aura les habitants de Armstrong eux-mêmes, pauvres et sans cesse sous pression qui se retrouveront parqués dans leur propre cité mais qui, à la fois victimes et coupables, n’ont rien de purs innocents (tous savent ainsi qui a assassiné, un an auparavant, un couple de vieillards pourtant apprécié dans Armstrong, mais tous se taisent). Leur révolte, leur colère sera brouillonne, désespérée, impuissante, leur frustration les amenant à mettre le feu à un stock de réfrigérateurs pourtant destiné à leurs propres familles.
Chaque groupe tire de son côté, joue sa propre partition et tous, d’une manière ou d’une autre, utilisent le drame de Brenda; et peu leur importe in fine la vérité!
Finalement, il y aura Freedomtown (voir le titre original du livre), le lieu de la révélation. Council mènera Brenda une nuit dans ce parc d’attractions à l’abandon depuis des années où pourrissent des reconstitutions grandeur nature de l’histoire américaine et livrera à la jeune fille les espoirs déçus de sa jeunesse dans cet endroit devenu un cimetière du rêve américain.
Impossible pour terminer de rendre compte comme il conviendrait de l’ample galerie des personnages totalement véridiques qui peuplent ce roman (le médecin des urgences, Ben le frère un peu étrange et mystérieux de Jesse Haus, Félicia Mitchell la responsable du programme d'études, Billy son compagnon ex-trader au chômage qui s’est construit un refuge au cœur de son appartement; ou tous les autres habitants de Armstrong, simples mères de familles ou petits délinquants; ou les inquiétants membres des "Amis de Kent" ou le collègue de Council dont le fils doit faire sa première apparition TV le soir du drame; et bien d’autres encore), ni des multiples scènes inoubliables et parfois hallucinantes -et qui paraissent tellement américaines- auxquelles on assiste, telles le show inouï des "Amis de Kent" avec discours, exposition d’handicapés aux premiers rangs, distribution d’équipement et lâché de ballons final; ou la marche de protestation menée par les pasteurs noirs dans les rues de Gannon dont les habitants, sur le pas de leur porte, regardent le passage comme s’il s’agissait d’un défilé ou d’une parade festive.
Dans ce roman, Richard Price fait preuve d’un sens exacerbé de la description, tant des lieux que des personnages, brossant des portraits réalistes, profonds, complexes, avec des dialogues marqués du sceau de la véracité, s’attachant à des gestes, des mimiques révélatrices d’un état d’esprit, le tout servi par une écriture au rythme lent, longues phrases qui soudain, au détour d’une virgule, assènent un détail évocateur, révélateur. Ce livre qui a quelque chose de la cartographie sociologique dresse un tableau terriblement désespérant d’une certaine Amérique urbaine (seulement d’une Amérique?); une œuvre puissante, marquante, qui tient de la tragédie classique (on n’est pas loin d’avoir une unité de temps, de lieu et d’action) où, contrairement au titre français, rien n’est ni tout noir, ni tout blanc.
Et à la fin, Lorenzo Council, lui, va continuer son boulot.
« (..) Lorenzo haussa les épaules. Longway avait raison. Aucun doute. Mais il fallait bien faire face. Au quotidien. »
D'autres chroniques de ce roman sur Polarnoir et chez Gridou
Fakirs (2009) de Antonin
Varenne. Editions Viviane Hamy - 2009; Points - 2010.
 John Nichols, un américain ex psychologue, s’est installé dans un tipi, en
marge d’un village du Lot, sur le terrain acheté par sa mère suite à l’échec d’une communauté hippy dans les années soixante-dix. Un jour, la gendarmerie locale le convoque pour le mettre en
contact téléphonique avec l’ambassade américaine à Paris. On lui apprend que son ami Alan Mustgrave, un américain comme lui, ancien de la première guerre d’Irak et qui exécutait un numéro de
fakir dans un petit cabaret underground parisien, vient de mourir sur scène, apparemment un accident ou peut-être un suicide, et que John est le seul à pouvoir reconnaître le corps. Monté à
Paris, John doute que son ami ait volontairement mis fin à ses jours et se met à enquêter. Sa route va croiser celle du lieutenant Guérin et de son adjoint Lambert qui constituent à eux deux la
brigade des suicidés de la PJ parisienne. Mis au placard suite à la mort d’un ancien collègue dont tous le rendent responsable, Guérin est un petit bonhomme étrange en quête d’une théorie qui
unifierait tous les suicides auxquels il est quotidiennement confronté.
John Nichols, un américain ex psychologue, s’est installé dans un tipi, en
marge d’un village du Lot, sur le terrain acheté par sa mère suite à l’échec d’une communauté hippy dans les années soixante-dix. Un jour, la gendarmerie locale le convoque pour le mettre en
contact téléphonique avec l’ambassade américaine à Paris. On lui apprend que son ami Alan Mustgrave, un américain comme lui, ancien de la première guerre d’Irak et qui exécutait un numéro de
fakir dans un petit cabaret underground parisien, vient de mourir sur scène, apparemment un accident ou peut-être un suicide, et que John est le seul à pouvoir reconnaître le corps. Monté à
Paris, John doute que son ami ait volontairement mis fin à ses jours et se met à enquêter. Sa route va croiser celle du lieutenant Guérin et de son adjoint Lambert qui constituent à eux deux la
brigade des suicidés de la PJ parisienne. Mis au placard suite à la mort d’un ancien collègue dont tous le rendent responsable, Guérin est un petit bonhomme étrange en quête d’une théorie qui
unifierait tous les suicides auxquels il est quotidiennement confronté.
Dans ce roman noir, bien qu’il y ait des flics et des cadavres, une -voire plusieurs- enquête(s) et même, in fine, un meurtrier, ce n’est pas du côté de l’intrigue que se trouve l’essentiel du plaisir procuré par sa lecture. D’ailleurs, lit-on des romans pour leur intrigue?
Pour la survoler quand même en deux mots, disons qu’il est question d’une mort suspecte, d’une thèse en psychologie non publiée pleine de révélations dérangeantes, des forces spéciales US lors de la première guerre d’Irak et de la torture, et de la CIA; et aussi d’un flic mort dans un incendie et de photos compromettantes; et de suicides et d’un couple mystérieux. Débrouillez-vous avec ça! C’est plaisant et intriguant à suivre, mené comme il faut par l’auteur. Mais ça n’a pour dessein que de faire se mouvoir des personnages. Et c’est là que le lecteur va trouver son bonheur: dans les personnages créés par Antonin Varenne, figures dont certaines sont quasi inoubliables.
Bon, ce n’est peut-être pas le cas de John Nichols, l’américain intellectuel/homme des bois tireur à l’arc installé dans le sud de la France, qui est le moteur de l’histoire principale, à savoir l’enquête sur la mort de son ami Alan, le fakir traumatisé masochiste homosexuel junkie. Ce personnage suscite aisément la sympathie du lecteur –un peu trop aisément, peut-être-, mais il est loin d’être totalement original.
Beaucoup plus intéressant en revanche est Guérin, le flic placardisé (au propre comme au figuré). Perpétuellement affublé d’un imperméable jaune trop grand pour lui –dont on finira par connaître l’origine et comprendre le rôle symbolique-, ce petit bonhomme introspectif est visiblement un bon enquêteur mais son comportement et une sombre histoire (dont on aura aussi le fin mot) le font être détesté de ses collègues. Borderline avec des comportements d’automutilation, il semble tirer son énergie, sa vitalité dans une recherche pour théoriser le monde, pour lui donner une cohérence, une logique qui n’y existe pas, s’amusant à tout bout de champ -ou croyant s’amuser?- à chercher des liens entre des éléments épars. Vivant seul avec le perroquet dépressif de sa mère décédée (mère dont le fantôme l’enveloppe comme une ombre), il côtoie quotidiennement la mort -peut-être lui-même est-il déjà mort?-.
Pour assister Guérin dans sa tâche, il y a Lambert, un jeune grand gaillard toujours revêtu de maillots de foot –une vocation brisée- que, de prime abord, on aura facilement tendance à croire un peu stupide –ce dont ne se privent pas les autres flics, n’hésitant pas à l’humilier, reportant sur lui leur haine de Guérin-. Mais à travers ses relations avec son supérieur, Varenne va révéler un individu beaucoup plus profond et complexe -et singulièrement attachant-, valant beaucoup plus que son milieu d’origine. Les rapports entre les deux hommes sont riches, faits d’admiration et d’affection réciproques, comme une étrange relation père-fils mais où chacun se verra à son tour endosser le rôle protecteur. Un attendrissant duo.
D’ailleurs, globalement, Varenne fait montre d’une réelle aptitude à faire vivre ses personnages, même secondaires comme les autres flics de la PJ, le supérieur hiérarchique de Guérin, le secrétaire de l’ambassade ou la patronne de la boîte de nuit où officiait Mustgrave par exemple; tous semblent illico dotée d’une réelle personnalité.
Autre personnage secondaire, Bunk’, le gardien de cimetière parisien affublé d’un bâtard de clebs nommé Mesrine qui va accueillir Nichols dans sa cabane. Au départ, ce personnage d’ancien taulard (dont le nom est une référence avouée -et de bon aloi- à l’auteur Edward Bunker) pourra paraître un rien convenu, dans le genre ours solitaire mais dont on sent un fond de bon cœur. Et puis...
Et puis je vais exercer pleinement mon droit à l’expression de ma subjectivité de lecteur car avec ce personnage, Varenne va me prendre par surprise:
Le déroulement de l’histoire fait que Bunk’, qui s’était totalement exclu du reste de l’humanité, reclus s’isolant/se protégeant du monde dans l’enceinte de son cimetière depuis sa sortie de prison, va se résoudre à s’extraire de son enfermement volontaire pour prendre le train et se rendre dans le Lot y récupérer des documents dans le tipi de John. Et là où une simple phrase aurait pu suffire pour relater ce voyage, Varenne va se laisser aller à décrire sur plusieurs pages le trajet physique et mental de ce vieil homme, qui, pour l’occasion, à ressorti son costard d’une autre époque (sa tenue d’homme... du monde?). Ce moment du roman, une sortie de prison plus de quinze ans après la levée d’écrou, est une formidable réussite: empreint d’une absolue humanité, émouvant sans une once de sensiblerie, juste par des détails, il fait partager au lecteur tout à la fois l’inquiétude et la surprenante –pour lui-même- joie -jamais pleinement avouée- de Bunk’, un sentiment intense d’une liberté enfin retrouvée qui semble même dépasser le personnage. Personnellement, rien que pour ces quelques pages...
Deux anecdotiques réserves cependant à l’égard de ce roman - légères réticences très loin toutefois de nuire à la qualité d’ensemble et au plaisir de lecture-: assez faible à mon goût est la description un rien grossière et qui semble se vouloir quasi sociologique du public assistant au spectacle du fakir, description qui paraît en fait empreinte de quelque chose d’amer, voire d’acrimonieux. De même, l'auteur glisse ailleurs une private joke pour happy fews (les noms d’une liste de suicidés que consulte Guérin) qui a quelque chose de malvenue. (A l’inverse, sans nuire en rien à son écriture limpide et plutôt directe, Varenne s’offre par moments quelques phrases métaphoriques, jetées avec parcimonie, dont le petit côté clin d’œil aux grands anciens du polar noir amènent le lecteur à sourire.)
La fin de ce livre -faisant intervenir un "méchant" guère intéressant lui-, n’apportera pas toutes les réponses. Tant mieux! Mais elle aurait pu être autre. J’aurais aimé qu’elle soit autre. Non qu’il y ait quoi que ce soit à lui reprocher en termes de cohérence par rapport au reste du récit ou autre; c’est juste que j’aurais aimé que la destinée des personnages soit différente; ils l’auraient mérité.
Au final, un roman noir où les intrigues les plus complexes, les plus énigmatiques se cachent dans les circonvolutions du cerveau des personnages.
Fakirs a remporté plusieurs prix et récompenses. Le lecteur averti sait la réticence –voire la méfiance- dont il convient de faire preuve à l’égard de ce genre de reconnaissance officielle. Pourtant, en l’occurrence, une telle méfiance n’est pas de mise.
D'autres avis à lire chez Moisson Noire, Black Novel, Action Suspense ou Les Gridouillis.
Melancholia (id – 2010), de Lars Von Trier, avec Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, John Hurt, Charlotte Rampling, Jesper Christiensen, Udo Kier, Alexander Skarsgård, Stellan Skarsgård, Brady Corbet.
 Justine et Michael célèbrent leur mariage dans la somptueuse
demeure de la sœur de Justine, Claire, et de son mari John. Mais au fur et à mesure que se déroule la réception, Justine parvient de moins en moins à dissimuler son état dépressif profond et la
soirée tourne au fiasco. Quelques temps plus tard, Justine ayant sombré plus encore dans la dépression, Claire la recueille chez elle, décidée à la prendre en charge. Pendant ce temps, la planète
Melancholia se rapproche de la Terre.
Justine et Michael célèbrent leur mariage dans la somptueuse
demeure de la sœur de Justine, Claire, et de son mari John. Mais au fur et à mesure que se déroule la réception, Justine parvient de moins en moins à dissimuler son état dépressif profond et la
soirée tourne au fiasco. Quelques temps plus tard, Justine ayant sombré plus encore dans la dépression, Claire la recueille chez elle, décidée à la prendre en charge. Pendant ce temps, la planète
Melancholia se rapproche de la Terre.
Lars Von Trier, j’avais arrêté après Dogville (Id - 2003). Pourtant, je suis de ceux qui avaient pris une énorme claque à la sortie de The element of crime (Forbrydelsens Element - 1984), avaient été conquis ensuite par les deux autres volets de sa trilogie européenne (Epidemic – 1987; Europa – 1991), été accro à sa délirante série L’hôpital et ses fantômes (Riget I & II – 1994, 1997) et étaient devenus fidèles des œuvres du danois. Puis, avec le temps, sans vraiment savoir pourquoi, comme une lassitude... Et là, la sortie de Melancholia, toujours sans vraiment savoir pourquoi -sensible peut-être aux échos favorables entendus ici ou là-, l’envie de "repiquer au truc". Bien m’en a pris! Parce que les films tels que celui-ci, ça ne court pas les salles de projection.
Le film débute par un prélude d’une petite dizaine de minutes qui est comme une sorte de 2001 - l’odyssée de
l’espace à l’envers: sur la musique "plein pot" de Wagner (Le prologue de Tristan & Iseult), après un long gros plan du visage
ravagé de Kirsten Dunst avec en arrière plan des oiseaux morts tombant du ciel(!), des images de deux planètes se rapprochant dangereusement -jusqu’à l’apocalyptique collision-
alternent avec d’autres, filmées en "hyper ralenti", insolites tableaux de personnages, d’animaux, de  paysages. Si un temps le spectateur
se risque à chercher une continuité dans tout cela, bien vite il abandonne pour se laisser subjuguer par l’incroyable beauté, la fantastique étrangeté de ce qui lui est montré. Rarement le cinéma
propose de telles visions! Plus tard, on comprendra qu’avec ce prélude, Lars Von Trier a déjà présenté l’intégralité de son film (on retrouvera dans son déroulement ultérieur des
séquences faisant écho ou reprenant des éléments de ces premiers tableaux pour les contextualiser), y compris sa fin, prévenant ainsi dès le départ de n’espérer aucun suspens, aucune surprise
quant à son terme; celui-ci est inéluctable, irrévocable et absolu. Là où Kubrick achevait son chef d’œuvre par une nouvelle aube de la vie, une renaissance, Lars Von
Trier commence son film par un crépuscule définitif et mortifère (Le crépuscule des dieux? pour rester dans le wagnérien). Tout est donc déjà écrit/filmé.
paysages. Si un temps le spectateur
se risque à chercher une continuité dans tout cela, bien vite il abandonne pour se laisser subjuguer par l’incroyable beauté, la fantastique étrangeté de ce qui lui est montré. Rarement le cinéma
propose de telles visions! Plus tard, on comprendra qu’avec ce prélude, Lars Von Trier a déjà présenté l’intégralité de son film (on retrouvera dans son déroulement ultérieur des
séquences faisant écho ou reprenant des éléments de ces premiers tableaux pour les contextualiser), y compris sa fin, prévenant ainsi dès le départ de n’espérer aucun suspens, aucune surprise
quant à son terme; celui-ci est inéluctable, irrévocable et absolu. Là où Kubrick achevait son chef d’œuvre par une nouvelle aube de la vie, une renaissance, Lars Von
Trier commence son film par un crépuscule définitif et mortifère (Le crépuscule des dieux? pour rester dans le wagnérien). Tout est donc déjà écrit/filmé.
Ensuite, après un très bref générique, rupture brutale de ton: la première partie de ce film qui en comporte deux (chacune baptisée du nom d’une des deux sœurs protagonistes principales: d’abord Justine, puis Claire) débute par une scène prosaïque où l’on retrouve la façon un rien chaotique de filmer caméra à l’épaule du danois: la limousine louée par les jeunes mariés est beaucoup trop longue pour pouvoir prendre le virage serré du chemin qui mène au lieu de la réception. Après de multiples tentatives de manœuvre inefficaces, ils devront s’y rendre à pied. Derrière la surface comique de cette situation, cette scène signifie d’emblée que cette union –et, en extrapolant, si l’on veut bien considérer le mariage comme un rituel pouvant sous-entendre la procréation, la vie en elle-même- est placée sous le signe de l’échec.
L’échec de ce mariage prendra effectivement corps petit à petit au cours de la soirée et de la nuit: Justine, centre de l’attention de sa famille et de ses amis, se montrera de plus en plus inapte à jouer son rôle d’heureuse jeune mariée, s’isolant de plus en plus fréquemment –détraquant ainsi le rigoureux planning mis au point par sa sœur pour la circonstance-, se repliant sur elle-même, révélant son âme fondamentalement dépressive. Jusqu’au petit matin où cette première partie s’achèvera sur la rupture d’avec son déjà ex-époux.
Entre-temps, cette longue séquence qui se voulait de fête (qui, par son dérèglement, en rappelle d’autres) aura permis de rencontrer de multiples personnages et révélé la vision sombre de l’humanité qu'a Lars Von Trier. Avec cette réception, le cinéaste portraiture en effet sans pitié (au risque du caricatural) une galerie de personnages masculins dont aucun n’est épargné: les hommes sont falots (Michael, le marié), immatures et égotiques (le père de Justine et de Claire), vénaux, manipulateurs et cruels (le patron de Justine), benêts ingénus (le neveu du patron de Justine), infantiles et grotesques (l’organisateur de la soirée), préoccupés par l’argent et lâches (John, le mari de Claire et beau-frère de Justine) ou serviles (le "petit-père", majordome de la demeure); comme pour dire en filigrane que, considérant ce que sont les humains mâles (qui sont les maîtres de cette planète), quel avenir espérer ?
Quant aux femmes, hors Justine et Claire (nous y reviendrons), le seul personnage féminin (les autres silhouettes femelles présentes à cette réception n’étant que des "Betty") est la mère des deux sœurs (excellente Charlotte Rampling!), femme froide, égoïste, caustique qui, d’une façon bien différente de Justine, semble elle aussi cependant avoir abandonné l’humanité (elle quittera la soirée en plein cours).
Cette première partie mettant en scène l’ensemble des acteurs, à souligner la qualité de la distribution: John Hurt est comme toujours parfait, ici en père vieux séducteur puéril et sur lequel on ne peut compter; tout comme l’est Charlotte Rampling, son ex-femme, aigrie, glaçante, acerbe, radicale. Stellan Skarsgård -un fidèle du réalisateur- campe un patron brutal, dotant son personnage de quelque chose d’un ogresque barbare. Et c’est avec plaisir qu’on croise un autre fidèle de Lars Von Trier, Udo Kier, en risible organisateur au comportement infantile. Même Kieffer Sutherland, plus sobre que d’habitude, est convainquant en mari businessman matérialiste sans chaleur.
 Concernant les deux actrices principales, Kirsten Dunst laisse pantois, révélant d’abord par touches (un regard, un
geste, une attitude) la profonde mélancolie qui habite Justine avant d’offrir quelques scènes d’une véracité crue lorsque son état se sera aggravé (l’impossibilité d'entrer dans la baignoire)
pour finir plus vivante que jamais, comme illuminée par une sérénité enfin atteinte. Et Charlotte Gainsbourg donne une émouvante épaisseur à son personnage de Claire,
apparaissant d’abord uniquement préoccupée du respect des convenances -et du planning de la soirée qu’elle a élaboré-, pour révéler ensuite sa chaleur envers sa soeur, son humanité, sa fragilité,
avant de basculer dans l’inquiétude, l’angoisse toutes terrestres.
Concernant les deux actrices principales, Kirsten Dunst laisse pantois, révélant d’abord par touches (un regard, un
geste, une attitude) la profonde mélancolie qui habite Justine avant d’offrir quelques scènes d’une véracité crue lorsque son état se sera aggravé (l’impossibilité d'entrer dans la baignoire)
pour finir plus vivante que jamais, comme illuminée par une sérénité enfin atteinte. Et Charlotte Gainsbourg donne une émouvante épaisseur à son personnage de Claire,
apparaissant d’abord uniquement préoccupée du respect des convenances -et du planning de la soirée qu’elle a élaboré-, pour révéler ensuite sa chaleur envers sa soeur, son humanité, sa fragilité,
avant de basculer dans l’inquiétude, l’angoisse toutes terrestres.
Car après cette première partie presque entièrement nocturne aux multiples personnages, la seconde, plus lumineuse (de fait,
Melancholia s’approchant, cette exoplanète éclairera la Terre comme une deuxième lune), sera centrée sur les deux sœurs. Deux sœurs à l’opposée l’une de l’autre: autant Justine est blonde, ronde,
voluptueuse (je défie quiconque d’oublier l’image d’elle nue au bord d’une rivière de nuit s’offrant à la lumière de Melancholia telle une Lorelei de fin du monde) et déjà évanescente, hors du
monde, autant Claire est brune, anguleuse, responsable, mère et partant accrochée à la Terre, à la vie. Et si Claire sera d’abord le soutien de Justine, ne ménageant pas ses efforts pour extraire
sa sœur de sa torpeur, de son enfermement, l’approche létale de Melancholia entraînera un basculement, un retournement de leur rapport. Tandis que Claire montera en panique, se débattant en vain
comme se révèlera à elle l’inéluctable, Justine, comme enfin délivrée, semblant  désormais la seule adaptée à cette nouvelle réalité (la fin du monde), gagnera en sérénité, accueillant comme
allant de soi l’inexorable; de protégée par Claire/la Terre, Justine/Melancholia deviendra la protectrice. Paradoxe "von trierien", ce qui nous paraissait une inadaptation, un handicap, une
incapacité à vivre dans le quotidien s’avèrera in fine une force, une aptitude mentale qui permettra à Justine d’accueillir paisiblement l’ultime fin. C’est elle qui sera le soutien de
Claire et son fils dans ces derniers instants, leur offrant, à travers un geste totalement dérisoire et irrationnel (mais quel geste ne le serait pas en de tels moments?), sa présence apaisante
pour faire face à une très belle apocalypse intime, à l’exact inverse des spectaculaires clichés hollywoodiens gavés d’effets spéciaux.
désormais la seule adaptée à cette nouvelle réalité (la fin du monde), gagnera en sérénité, accueillant comme
allant de soi l’inexorable; de protégée par Claire/la Terre, Justine/Melancholia deviendra la protectrice. Paradoxe "von trierien", ce qui nous paraissait une inadaptation, un handicap, une
incapacité à vivre dans le quotidien s’avèrera in fine une force, une aptitude mentale qui permettra à Justine d’accueillir paisiblement l’ultime fin. C’est elle qui sera le soutien de
Claire et son fils dans ces derniers instants, leur offrant, à travers un geste totalement dérisoire et irrationnel (mais quel geste ne le serait pas en de tels moments?), sa présence apaisante
pour faire face à une très belle apocalypse intime, à l’exact inverse des spectaculaires clichés hollywoodiens gavés d’effets spéciaux.
De ce riche film, on pourrait encore relever quelques très belles idées cinématographiques (le jouet bricolé par l’enfant permettant de visualiser l’avancée de Melancholia), s’extasier sur moult images empreintes de romantisme allemand (les deux femmes galopant dans la brume du petit matin), trouver des références à Tarkovski, à Bunuel peut-être même.
Au final, avec ce film, avec le personnage de Justine, Lars Von Trier a donné chair à son pessimisme fondamental (sur le long terme, qui lui donnerait tort?), a exposé son nihilisme cosmique ("Il n’y a nulle vie hors de Terre", fait-il dire à son personnage féminin– encore une chose qui l’oppose à 2001). Un film sans doute un peu froid (Lars Von Trier ne permet guère l’identification aux personnages, renonçant à tout effet facile favorisant un tel transfert), sans doute "intellectuel"; mais que l’on adhère ou non à son propos, force est de constater qu’il a réussi là une fascinante et très belle œuvre d’art.
Padana City (Nordest – 2005) de Massimo Carlotto & Marco Videtta, traduit de l’italien par Laurent Lombard. Editions Métailié – 2008.
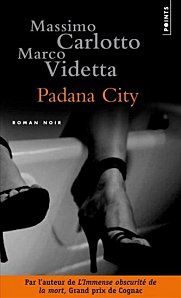 Un soir, à quelques jours de son mariage, Francesco Visentin, jeune avocat rejeton d’une riche famille locale et destiné à une brillante carrière, se rend chez sa fiancée Giovanna et la
trouve morte dans sa baignoire. Très vite, la police conclue à un meurtre. Francesco apprend ensuite d’une amie de Giovanna, Carla, que sa fiancée avait un amant avec qui elle avait décidé de
rompre et de venir tout lui raconter. Francesco soupçonne d’abord Filippo Calchi Renier, son ex-ami d’enfance, artiste dilettante fils d’une riche comtesse, avant d’être rapidement convaincu que
l’amant de Giovanna était un autre homme. Il se met alors à enquêter parallèlement à la police et découvre que cet assassinat pourrait avoir un rapport avec les recherches que Giovanna menait sur
l’incendie de l’entreprise de son père, disparu depuis des années, et pour lequel il fut condamné.
Un soir, à quelques jours de son mariage, Francesco Visentin, jeune avocat rejeton d’une riche famille locale et destiné à une brillante carrière, se rend chez sa fiancée Giovanna et la
trouve morte dans sa baignoire. Très vite, la police conclue à un meurtre. Francesco apprend ensuite d’une amie de Giovanna, Carla, que sa fiancée avait un amant avec qui elle avait décidé de
rompre et de venir tout lui raconter. Francesco soupçonne d’abord Filippo Calchi Renier, son ex-ami d’enfance, artiste dilettante fils d’une riche comtesse, avant d’être rapidement convaincu que
l’amant de Giovanna était un autre homme. Il se met alors à enquêter parallèlement à la police et découvre que cet assassinat pourrait avoir un rapport avec les recherches que Giovanna menait sur
l’incendie de l’entreprise de son père, disparu depuis des années, et pour lequel il fut condamné.
Pour qui a aimé les romans de Massimo Carlotto, son tranchant, les analyses fouillées et complexes de ses personnages ou l’acuité de son regard sur la société italienne, ce Padana City constitue un désappointement, tant tout y est superficiellement traité. Si l’on peut apprécier l’intention de ce roman –qui, partant d’un crime apparemment passionnel, va élargir son champ vers la dénonciation des comportements népotiques, cyniques, vénaux, immoraux et autocratiques des grandes familles du nord-est de l’Italie, dirigeants de l’industrie et autres puissants notables–, pour ce qui est de la forme, malheureusement, l’impression laissée est plus proche du synopsis d’un film à venir que d’un réel roman. Il y a à la fois trop et pas assez; une grande surface couverte, mais de peu d’épaisseur.
Ce sera principalement à travers le personnage de Francesco que le lecteur va suivre cette intrigue. Un temps soupçonné du meurtre de sa fiancée mais très vite blanchi, ce fils de très bonne famille à qui est promise la succession du cabinet d’avocats de son père –à la clientèle composée de riches dirigeants d’entreprises-, d’abord accablé et incrédule devant les révélations de Carla (on le serait à moins!), va pourtant très rapidement remonter la pente (!) pour mener son enquête. Les auteurs nous ont concocté-là un héros de bien peu d’épaisseur, du genre fadasse bellâtre fortuné, qui n’attire en rien ni la sympathie, ni l’empathie. Et, disons-le d’emblée, parvenant évidemment à découvrir le fin mot de l’histoire, il se verra au bout du compte confronté au dilemme de mettre en balance la vérité et sa carrière future (original, non?!), devant pour se faire affronter son surmoi paternel et "tuer l’image du père" (freudisme de comptoir)... Bâillement.
A propos de freudisme du café du commerce, voici Filippo, l’ex-ami de Francesco, fils de la riche comtesse Calchi Renier. On a avec ce personnage une quasi caricature du fils de bonne famille dévoyé: dépressif mais artiste, ce sculpteur en chambre à l’œuvre unique -une sculpture de femme (la Femme!) pour laquelle sa mère sert de modèle(!)-, est bien sûr étouffé par ladite mère, génitrice castratrice. Mais grâce à un transfert (dans l’acception freudienne du terme) sur ladite sculpture, Filippo parviendra à s’extraire de son emprise... Freudisme de bazar, deuxième! Et nouveau bâillement. De plus, si ce personnage présente en début de roman quelque utilité pour l’intrigue en tant que suspect potentiel du meurtre, il est lui aussi bien vite disculpé, et pourtant on aura droit de-ci de-là, jusqu’au bout du livre, à quelques paragraphes consacrés à ses relations pour le moins ambiguës avec sa mère dont l’intérêt m’échappe encore...
Dans le même esprit "Freud Pour Les Nuls", on pourra encore ajouter un petit coup de "retour du refoulé" avec la réapparition du père de Giovanna, brave homme que tous croyaient disparu et qui fût... oui, oui, c’est bien ça... condamné à tort pour l’incendie volontaire de sa société pour toucher l’assurance...
Dominant/écrasant les deux figures de fils, il y a donc celle du père de Francesco, Antonio Visentin, ce notable veuf encore bel homme respecté et salué par tous, et celle de la mère de Filippo, Selvaggia Calchi Renier, femme de basse extraction devenue richissime par un heureux mariage, vénéneuse veuve à poigne dominatrice et hautaine, elle aussi évidemment "bien conservée". Ces personnages brossés à traits plutôt grossiers sont les maîtres du coin, dirigeants de la très puissante Fondation Torrefranchi qui investit dans les entreprises les plus florissantes de la région.
Autour de ceux-là, les auteurs ont accumulé une foultitude d’autres personnages plus ou moins –plutôt moins que plus- élaborés: il y a Carla, l’amie de Giovanna qui, d’abord hostile à Francesco, fera ensuite rapidement cause commune avec lui (original, ça!) pour aller au terme de cette enquête. Il y a Giacomo Zuglio, banquier usurier combinard nouveau riche impliqué dans l’incendie de l’entreprise du père de Giovanna. Et voici maintenant le journaliste de la télé locale, veule et plutôt stupide, totalement soumis aux pressions des actionnaires possédant le média qui l’emploie (actionnaires dont le plus important est... oui, oui, vous l’avez deviné... la fondation dirigée par le père de Francesco et de la mère de Filippo). Et puis un fou sans nom, clochard braillant dans les rues qui semble connaître la vérité sur l’histoire du père de Giovanna mais qui n’aura strictement aucun rôle à jouer dans le déroulement de l’intrigue (quant à l’absolument inédite idée du simple d’esprit qui connaît la vérité... inutile de s’étendre...). Et il y a encore une bande de loubards en 4X4 qui agressent et dévalisent des vieillards la nuit dans leurs maisons mais qui connaîtront les foudres de la justice divine (enfin, en l’occurrence, celles de la circulation automobile), hormis l’un d’eux, survivant qui, justement, apparaissait en compagnie de Giovanna sur une photo découverte par Francesco (heureuse coïncidence!) et à propos duquel notre enquêteur en herbe découvrira que... bon sang, incroyable!... et qui, repentant, avouera que... non ?! Mais ce n’est pas tout: il y a encore le tueur de la mafia roumaine, l’autre ami d’enfance de Francesco prête-nom arrogant pour le compte de la fondation, quelques mères alcooliques et/ou quasi-autistes, le flic intègre –mais moyennement efficace- qui enquête pour un juge lui plutôt réceptif aux pressions des puissants... Ajoutez à cela une pincée de racisme avec chasse à l’immigré, un rien de manipulation par les médias... Stop! Assez!
On est en fait proche du fatras, de l’agrégat de clichés mille fois lus et vus où l’accumulation fait office de profondeur, la plupart de tout cela enrobant inutilement le fond de l’histoire, la dénonciation de gros industriels s’acoquinant avec la mafia pour se débarrasser de leurs déchets toxiques. Euh... tant qu’à faire, on y mettra en plus un p’tit coup de délocalisation vers les pays de l’est, tiens!
Ajoutant encore à ce côté "ça part tous azimuts", le roman alterne passages à la première personne du singulier -la narration étant alors faite par Francesco-, et passages à l’impersonnelle troisième personne -ceux dont est absent Francesco-, ce qui donne un sentiment de discontinuité et l’impression que les auteurs n’ont pas su comment s’y prendre pour révéler certains éléments de l’histoire en s’en tenant à un narrateur unique. A moins que cela ne reflète simplement la façon dont ils se sont répartis le travail d’écriture?
Pour en venir à l’aspect polar, ce roman est aussi un whodunit. Malheureusement, quiconque pratique le jeu du "Voyons voir, quel est le personnage sur lequel pèse le moins de soupçons?" n’aura nul besoin d’attendre que les auteurs livrent, à la fin, l’identité de l’assassin de Giovanna, l’ayant découvert par lui-même bien avant d’atteindre la moitié du roman.
Finalement, cette chronique est celle d’une attente déçue; et partant d’une sévérité sans doute excessive. L’intention des auteurs d’ancrer un polar dans la réalité des dérives capitalistes et des accointances mafieuses des riches industriels du nord de l’Italie est louable et il y avait-là matière à un excellent roman noir qui aurait dresser un tableau effrayant et désolant d’une région d’Europe, comme le laisse espérer le prometteur premier chapitre... si ce livre avait été épuré de ses intrigues secondaires sans intérêt et débarrassé de ses scories psychologisantes pour se concentrer plus en profondeur sur le cœur de son propos et donner corps à des vrais personnages au lieu de clichés. Mais parce que c’est loin d’être mal écrit et traite d’un vrai sujet noir, ce roman se lit; et puis s’oublie. Dommage...
PS. Le titre en français fait référence à la Padanie, terme employé pour désigner le nord de l’Italie (à partir de là-où la "botte" s’évase), mis au goût du jour par la Ligue du Nord.
La pâle figure (The pale criminal – 1990), de Philip Kerr, traduit de l’anglais par Gilles Berton.
 Berlin, été 1938. Dans le courrier du matin de l’agence de
détectives de Bernhardt "Bernie" Gunther et son associé Bruno Stahlecker, une lettre anonyme de quelqu’un voulant le rencontrer à minuit dans les ruines du Reichstag, à propos d’une vieille
affaire. A ce rendez-vous, Bernie se retrouve face à son ancien patron, Arthur Nebe, le chef de la Police criminelle de Berlin, qui, à la demande de Heydrich (qui dirige toutes les polices
politiques et criminelles au sein du RSHA, le Service de Sécurité central du Reich), veut qu’il réintègre la Kripo (Kriminalpolizei). Bernie réserve sa réponse, tout en sachant qu’à terme, il
n’aura pas le choix. Le lendemain, il se rend chez une riche cliente victime de chantage: son fils, homosexuel, risque d’être interné dans un camp de travail car un maître chanteur menace de
rendre public les lettres explicites que celui-ci a écrit à son amant le docteur Kindermann. Se faisant payé un séjour dans la clinique pour gens fortunés de Kindermann, Bernie découvre
rapidement que le maître chanteur est un ex infirmier, Klaus Hering. Lors de la remise de l’argent en échange d’une des lettres, Bernie et Bruno filent le maître chanteur jusqu’à son domicile.
Tandis que Bruno surveille l’immeuble, Bernie rentre chez lui. Mais en pleine nuit, il est réveillé et embarqué au quartier général de la Gestapo. Là, il apprend que Bruno a été assassiné. Puis
il rencontre Heydrich qui lui intime personnellement de revenir à la Kripo. Bernie renâcle, désireux d’abord de trouver l’assassin de son collègue. Mais l’affaire est déjà réglée! La police ayant
trouvé dans une poche de Bruno un papier sur lequel était écrit le nom de Hering, elle s’est rendue chez l’ancien infirmier où elle a découvert l’arme du crime et Hering pendu. Examinant les
lieux, Bernie constate vite que ce suicide est en fait un meurtre maquillé. Mais n’ayant plus d’argument à opposer à Heydrich, Bernie se retrouve donc à la Kripo, avec le grade de
Kriminalkommissar, à la tête d’une équipe chargée de découvrir qui a violé, mutilé puis tué quatre adolescentes typiquement aryennes en quatre mois. Mais les deux affaires ne sont pas sans liens
et cachent quelque chose de plus vaste...
Berlin, été 1938. Dans le courrier du matin de l’agence de
détectives de Bernhardt "Bernie" Gunther et son associé Bruno Stahlecker, une lettre anonyme de quelqu’un voulant le rencontrer à minuit dans les ruines du Reichstag, à propos d’une vieille
affaire. A ce rendez-vous, Bernie se retrouve face à son ancien patron, Arthur Nebe, le chef de la Police criminelle de Berlin, qui, à la demande de Heydrich (qui dirige toutes les polices
politiques et criminelles au sein du RSHA, le Service de Sécurité central du Reich), veut qu’il réintègre la Kripo (Kriminalpolizei). Bernie réserve sa réponse, tout en sachant qu’à terme, il
n’aura pas le choix. Le lendemain, il se rend chez une riche cliente victime de chantage: son fils, homosexuel, risque d’être interné dans un camp de travail car un maître chanteur menace de
rendre public les lettres explicites que celui-ci a écrit à son amant le docteur Kindermann. Se faisant payé un séjour dans la clinique pour gens fortunés de Kindermann, Bernie découvre
rapidement que le maître chanteur est un ex infirmier, Klaus Hering. Lors de la remise de l’argent en échange d’une des lettres, Bernie et Bruno filent le maître chanteur jusqu’à son domicile.
Tandis que Bruno surveille l’immeuble, Bernie rentre chez lui. Mais en pleine nuit, il est réveillé et embarqué au quartier général de la Gestapo. Là, il apprend que Bruno a été assassiné. Puis
il rencontre Heydrich qui lui intime personnellement de revenir à la Kripo. Bernie renâcle, désireux d’abord de trouver l’assassin de son collègue. Mais l’affaire est déjà réglée! La police ayant
trouvé dans une poche de Bruno un papier sur lequel était écrit le nom de Hering, elle s’est rendue chez l’ancien infirmier où elle a découvert l’arme du crime et Hering pendu. Examinant les
lieux, Bernie constate vite que ce suicide est en fait un meurtre maquillé. Mais n’ayant plus d’argument à opposer à Heydrich, Bernie se retrouve donc à la Kripo, avec le grade de
Kriminalkommissar, à la tête d’une équipe chargée de découvrir qui a violé, mutilé puis tué quatre adolescentes typiquement aryennes en quatre mois. Mais les deux affaires ne sont pas sans liens
et cachent quelque chose de plus vaste...
Après L’été de cristal (March violets – 1989 – on en causait ici), La pâle figure est le deuxième volet de la trilogie Berlin noir de Philip Kerr narrant les aventures de Bernhardt Gunther, détective hard boiled exerçant sa profession au cœur du régime nazi.
Comme on l’a déjà dit précédemment, Philip Kerr a écrit sa trilogie sous l’égide des grands anciens Chandler et Hammett (avec ici ce qui semble une référence directe au Faucon maltais, puisque, comme dans le roman de Dash, le collègue du héros est assassiné dès les premières pages). Bernie Gunther est un privé dur à cuire typique, insolent à la réplique percutante (tant verbale que physique...), la clope au bec, le chapeau vissé sur le crâne. Comme il se décrit lui-même: "Je ne suis pas un chevalier blanc. Je suis juste un type usé, debout à un coin de la rue dans son pardessus froissé, avec une vague notion de ce qu’on appelle, osons le mot, Moralité. Bien sûr, je ne suis pas étouffé par les scrupules quand il s’agit de me remplir les poches (...)." Et comme dans les œuvres des deux figures tutélaires, le héros de Kerr va mener une enquête qui le conduira à naviguer à vue dans les eaux troubles et hypocrites du pouvoir et de l’argent. De ce point de vue polar, on prend plaisir à cette intrigue bien conçue, avec ses coups de théâtre, ses révélations, ses fausses pistes, ses rebondissements, à cette enquête qui va amener Bernie à séjourner dans une clinique pour rupins, à participer à une séance de spiritisme, à se trouver mêler aux luttes de pouvoir entre dignitaires du régime ou à se rendre dans une de ces sortes de "nouvelles baronnies" (ici Nuremberg) où celui qui dirige la région, intouchable, règne en tyran sur tout et sur tous, et "aime s’offrir un bon petit pogrom personnel de temps en temps."
Mais on l’aura compris, ce qui étoffe cette trame polardeuse, ce qui fait l’attrait original de la trilogie de Kerr, c’est son contexte spécifique: nous sommes en plein IIIe Reich et les personnages que l’on y croise ont pour nom Heydrich ou Himmler...
Alors, bien sûr, d’une part l’"Histoire en marche" (1938, c’est la crise des Sudètes, les accords de Munich) est évoquée par moments. Mais surtout, Kerr installe son roman dans une ambiance quotidienne malsaine, malade et nauséabonde, faite d’exacerbation de l’antisémitisme, d’endoctrinement des enfants, de propagande infâme d’une presse ignoble et de propos abjects de quidams exprimant une adhésion de plus en plus manifeste à l’égard du régime en place. Il profitera également d’avoir mis sous les ordres de Bernie une équipe d’inspecteurs pour décrire toute une palette d’attitudes et comportements de flics que leur permet le pouvoir dont ils disposent ou s’octroient.
Enrichissant plus encore ce roman, dans un tel environnement, Kerr a fait de son personnage principal un individu qui n’a nullement la pure blancheur du héros irréprochable que l’on aurait pu craindre. Au contraire, Bernie ne manque pas d’ambivalence: s’il est indiscutablement à mille lieux d’adhérer à l’idéologie dominante et au pouvoir du moment, il n’en est cependant pas un opposant engagé, n’a guère de conscience politique et, commissaire de police, il travaille –même si c’est au départ contre son gré- pour ce pouvoir. Bernie porte en lui certaines ambiguïtés renforçant l’intérêt pour ce personnage qui paraît tout à la fois lucide sur son temps ("C'est toujours au moment où l’on pense que les choses ne peuvent plus empirer qu’on se rend compte qu’elles sont déjà bien pires qu’on ne le pensait. Et qu’elles empirent encore.") et sur ce qui se dessine (à savoir la guerre), mais qui ne s’extrait pas pour autant de l’atmosphère générale, n’échappant pas totalement à la pensée dominante, comme le prouvent ses réflexions sur les homosexuels ("(...) et puis, c’était une tante.") ou ses considérations sur les juifs ("Il est vrai, me disais-je, que ce problème ne me concerne guère, que les juifs ont bien cherché ce qui leur arrive.")*
Avec ce deuxième volume de sa trilogie, Kerr, tout en restant dans le domaine du polar, a su, plus que dans le précédent, imbriquer la trame de son intrigue à des évènements réels pour en faire un roman plus fort. Quant à Bernie, on aura eu le sentiment de voir se craqueler son cynisme, de devenir plus sensible à la réalité de ce qui se passe autour de lui. Et au final, même s'il parviendra évidemment à dénouer tous les fils de son enquête et mettre à jour ce qui s'ourdissait dans l'ombre du pouvoir, il sera impuissant à détourner le cours des évènements et sera rattrapé par l’Histoire lorsqu’il marchera dans les rues de Berlin en ce matin tout particulier du 10 novembre 1938.
* Prenons garde aux interprétations erronées que l’on risquerait d’attribuer à cette phrase de Bernie si l’on oublie la réalité du contexte historique: en 1938, les mesures officielles prises par le régime nazi à l’encontre des juifs concernaient seulement (si l’on ose dire...) des domaines tels que des restrictions dans l’accès aux emplois ou dans l’exercice des certaines professions, l’obligation de déclaration des biens immobiliers ou l’interdiction d’associations par exemple. Si l’antisémitisme " était dans l’air" et, plus que cela, se manifestait concrètement –et violemment- tous les jours, il n’était toutefois pas encore alors explicitement question d’extermination, la mise en œuvre de la solution finale ne viendra que plus tard, lors de la conférence de Wannsee, en janvier 1942, dirigée par... Heydrich.