L'ange déchu (Fallen angel – 1965) de Howard Fast, traduit de l'anglais (américain) par Mme Tesnières.
 David Stillman est un technicien commercial qui calcule le prix de revient
de produits pour une entreprise située dans un gratte-ciel de New York. Un jour, en fin d'après-midi, se produit une coupure de courant. David quitte son poste au vingt-deuxième étage et
entreprend de descendre dans le noir par les escaliers du building. En chemin, une troublante inconnue, qui semble pourtant le connaître, l'aborde et lui déclare que le responsable de la panne
est un certain Vincent, puis disparaît par les sous-sols de l'immeuble. Dans la rue, David est attiré par un rassemblement de badauds et de policiers autour du corps d'un homme, un ponte de
l'industrie et familier des hautes sphères de l'État qui s'est apparemment suicidé en se jetant du haut de la tour. Parvenu à son appartement, David y trouve un gros-bras armé se disant envoyé
par Vincent qui lui intime l'ordre de partir pour la Hongrie, lui fournissant les papiers nécessaires. David parvient à mettre l'autre dehors à coup de poings. Mais les évènements étranges et
inexplicables se multipliant ensuite autour de lui, David commence à se demander s'il n'est pas en train de devenir fou.
David Stillman est un technicien commercial qui calcule le prix de revient
de produits pour une entreprise située dans un gratte-ciel de New York. Un jour, en fin d'après-midi, se produit une coupure de courant. David quitte son poste au vingt-deuxième étage et
entreprend de descendre dans le noir par les escaliers du building. En chemin, une troublante inconnue, qui semble pourtant le connaître, l'aborde et lui déclare que le responsable de la panne
est un certain Vincent, puis disparaît par les sous-sols de l'immeuble. Dans la rue, David est attiré par un rassemblement de badauds et de policiers autour du corps d'un homme, un ponte de
l'industrie et familier des hautes sphères de l'État qui s'est apparemment suicidé en se jetant du haut de la tour. Parvenu à son appartement, David y trouve un gros-bras armé se disant envoyé
par Vincent qui lui intime l'ordre de partir pour la Hongrie, lui fournissant les papiers nécessaires. David parvient à mettre l'autre dehors à coup de poings. Mais les évènements étranges et
inexplicables se multipliant ensuite autour de lui, David commence à se demander s'il n'est pas en train de devenir fou.
Voilà un roman qui a l’air au départ d’un petit polar plutôt sympathique rappelant furieusement certains films d'Alfred Hitchcock: un homme ordinaire se retrouve au milieu d'une série d'évènements dont le sens lui échappe et doit sans cesse fuir devant des poursuivants sans savoir pourquoi on le traque ; hitchcockien en diable également sera le mac guffin'. Un livre qui fleure donc bon les années 50-60 et nous plonge dans une intrigue qui prend le lecteur et le tient en haleine, et ce malgré une trame par moments un peu cousue de fil blanc et quelques scènes dont la cohérence ne paraît pas évidente (mais il faudrait voir quelle est la part due à la traduction, tant celle-ci ne semble pas toujours optimale).
Mais au-delà, au cours du récit, l'auteur insiste de plus en plus sur le ressenti de son personnage principal, à savoir la peur. Et alors, petit à petit, on réalise, pour peu que l'on connaisse un minimum la vie d'Howard Fast, qu'il parle de ses propres sentiments et de ses propres émotions, éprouvés lorsqu'il s'est retrouvé dans le collimateur de la Commission des Activités Anti-américaines du sénateur Mac Carthy. Ce qu’il nous fait partager alors, c’est l'angoisse d'être seul, traqué, interrogé, poursuivi par une entité protéiforme, la frayeur d’être pourchassé par une "instance supérieure" alors que l’on n’a commis aucune faute. Ainsi, c’est sans doute plus Howard Fast lui-même que David Stillman qui dit: "Nous étions humains, naguère, bons et affectueux, pleins de tendres pensées et de tendres espoirs. Mais des hommes terribles étaient intervenus dans nos vies avec leurs redoutables méthodes. (...)".
Dans les derniers chapitres, Howard Fast l'homme de gauche va plus loin: toujours à travers Stillman, il cherche à mettre en garde le lecteur contre ces hommes de pouvoir au charisme fascinant/fascisant qui, que ce soit du haut de leur building/tour d'ivoire, depuis une tribune ou à travers un écran de télévision, exercent leur puissance en ne considérant le reste de l'humanité que comme quantité négligeable évaluable essentiellement en terme de coûts/bénéfices: "(…) Il m'a donc parlé. Il m'a donné une leçon sur le calcul de prix de revient. Il connaissait tout cela sur le bout des doigts... le prix minimum de la destruction de la vie humaine. Si on considérait le prix de revient, en effet, ce gaz battait la bombe atomique à plate couture (…)". Et plus loin: "J'aurai donné ma vie pour lui. Mais il me demandait davantage. Il est allé jusqu'à me donner une leçon de choses. Il m'a appelé auprès de lui... la voix était la même, l'homme n'avait pas changé, et je crois qu'alors encore, j'aurais pu volontiers sauter par cette fenêtre, si ma mort avait pu être utile. Mais ce n'était pas pour ça qu'il m'avait appelé. C'était pour regarder les passants, pour les regarder du vingt-deuxième étage. Ce n'étaient que des petits points noirs et nous, nous étions des géants. En bas, il y avait les fourmis, des fourmis, sans plus. On foule la terre, et, si on écrase un univers de fourmis, on ne s'arrête pas pour autant. On poursuit sa route (…)".
Selon Howard Fast, existaient donc dans les années 60 des hommes de pouvoir aux yeux de qui la vie des autres êtres humains pouvait n’être rien de plus que des chiffres, une chose qui se calcule, s'évalue, s’estime uniquement en fonction de ce qu’elle coûte et de ce qu’elle rapporte. Ces hommes ont-ils aujourd’hui disparu ou bien au contraire... ?



 Treme, du nom d'un quartier de la Nouvelle-Orléans, s'attache à suivre, trois mois
après le passage dévastateur de l'ouragan Katrina, le quotidien de quelques habitants de la ville: Antoine Baptiste, un tromboniste désargenté qui court le cachet et réside dans une modeste
maison avec femme et bébé. Il est le père de deux autres grands garçons qu'il a eus d'un précédent mariage avec LaDonna. Celle-ci vit entre Bâton-Rouge, où habitent ses enfants et son nouveau
mari, et La Nouvelle-Orléans, où elle gère un bar. Elle est à la recherche de son frère Daymo, disparu suite à l'ouragan, et est aidée et soutenue en cela par Toni Bernette, une avocate des
droits civiques. Cette dernière est la femme de Creighton Bernette, un universitaire enseignant la littérature, écrivain en panne d’inspiration et fervent défenseur de la ville et de sa culture.
Janette Desautel est un chef qui se débat pour maintenir à flot son restaurant. Elle est plus ou moins la petite amie de Davis Mac Alary, animateur radio et musicien, admirateur passionné et
thuriféraire exalté de la musique locale. Albert "Big Chief" Lambreaux est un irascible mais respecté chef "indien" qui, revenant à la Nouvelle-Orléans, a trouvé sa maison dévastée et s’est
installé dans un bar abandonné pour y rassembler sa tribu et y façonner les costumes de sa parade. Son fils, qui vit à New-York, est un trompettiste de jazz réputé. Annie et Sonny enfin, sont
deux jeunes musiciens des rues.
Treme, du nom d'un quartier de la Nouvelle-Orléans, s'attache à suivre, trois mois
après le passage dévastateur de l'ouragan Katrina, le quotidien de quelques habitants de la ville: Antoine Baptiste, un tromboniste désargenté qui court le cachet et réside dans une modeste
maison avec femme et bébé. Il est le père de deux autres grands garçons qu'il a eus d'un précédent mariage avec LaDonna. Celle-ci vit entre Bâton-Rouge, où habitent ses enfants et son nouveau
mari, et La Nouvelle-Orléans, où elle gère un bar. Elle est à la recherche de son frère Daymo, disparu suite à l'ouragan, et est aidée et soutenue en cela par Toni Bernette, une avocate des
droits civiques. Cette dernière est la femme de Creighton Bernette, un universitaire enseignant la littérature, écrivain en panne d’inspiration et fervent défenseur de la ville et de sa culture.
Janette Desautel est un chef qui se débat pour maintenir à flot son restaurant. Elle est plus ou moins la petite amie de Davis Mac Alary, animateur radio et musicien, admirateur passionné et
thuriféraire exalté de la musique locale. Albert "Big Chief" Lambreaux est un irascible mais respecté chef "indien" qui, revenant à la Nouvelle-Orléans, a trouvé sa maison dévastée et s’est
installé dans un bar abandonné pour y rassembler sa tribu et y façonner les costumes de sa parade. Son fils, qui vit à New-York, est un trompettiste de jazz réputé. Annie et Sonny enfin, sont
deux jeunes musiciens des rues.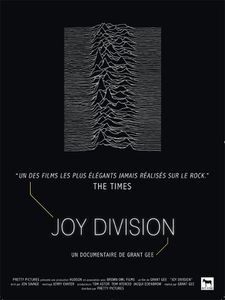 D’emblée, ce film qui retrace la carrière météorique (4 ans d’existence et
deux albums studio sous le nom de Joy Division) et pourtant durablement marquante du groupe, le resitue dans son environnement originel: le Manchester de la fin des années 70,
c’est-à-dire une ville du nord de l’Angleterre, en pleine désindustrialisation, avec des quartiers misérables qui semblent encore appartenir à la fin du XIXème siècle, des rues où s’alignent des
petites maisons toutes semblables accolées les unes aux autres, des terrains vagues, des ruelles sordides où jouent des enfants, une cité couleur gris-usine (Bernard Sumner avoue
ainsi n’avoir jamais vu un arbre avant l’âge de 9 ans!). Et la très bonne idée du réalisateur, associer à ces images les premiers morceaux de ce qui deviendra Joy Division,
apparaît alors comme une évidence. Oui, c’est de là que vient la musique de Joy Division et c’est de cela qu’elle parle: la douleur/cri de l’individu sur fond de noirceur
industrielle.
D’emblée, ce film qui retrace la carrière météorique (4 ans d’existence et
deux albums studio sous le nom de Joy Division) et pourtant durablement marquante du groupe, le resitue dans son environnement originel: le Manchester de la fin des années 70,
c’est-à-dire une ville du nord de l’Angleterre, en pleine désindustrialisation, avec des quartiers misérables qui semblent encore appartenir à la fin du XIXème siècle, des rues où s’alignent des
petites maisons toutes semblables accolées les unes aux autres, des terrains vagues, des ruelles sordides où jouent des enfants, une cité couleur gris-usine (Bernard Sumner avoue
ainsi n’avoir jamais vu un arbre avant l’âge de 9 ans!). Et la très bonne idée du réalisateur, associer à ces images les premiers morceaux de ce qui deviendra Joy Division,
apparaît alors comme une évidence. Oui, c’est de là que vient la musique de Joy Division et c’est de cela qu’elle parle: la douleur/cri de l’individu sur fond de noirceur
industrielle.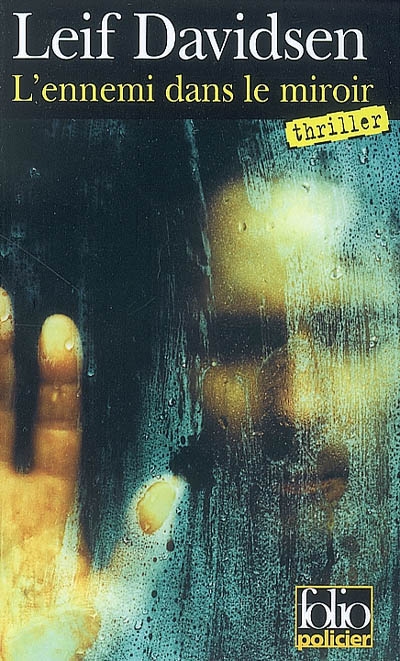 Quelques années après sa mission danoise, Vuk, le tueur serbe,
a refait sa vie aux USA. Il est devenu John Ericsson, guide dans le désert de la Death Valley pour riches touristes en mal de sensations et s'est fondu, avec femme et enfants, dans la banalité du
mode de vie banlieusard américain. Mais le 11/09/2001 fait exploser son tranquille quotidien: toutes les forces de police américaines sont sur le pied de guerre et vérifient la situation des
immigrés sur leur territoire. Vuk/John est arrêté et identifié. Pour le commissaire des services de renseignements de la police danoise Per Toftlund, le 11/09/2001 marque aussi un changement: il
est placé à la tête d'une cellule spéciale des services secrets dont la mission est de collecter des informations sur les réseaux islamistes. Un jour, Per apprend l'arrestation de Vuk et attend
alors avec un sentiment de vengeance son extradition au Danemark. Quelques temps après, c'est de la mort de Vuk -frustrante pour Per- lors d'une tentative d'évasion dont on informe Toftlund. En
réalité, les services secrets américains considèrent Vuk comme très intéressant du fait de sa connaissance des milices islamistes acquise durant la guerre des Balkans et donc comme pouvant
leur être potentiellement -et secrètement- utile. Ainsi, Toftlund et Vuk se retrouvent tous deux impliqués dans la nouvelle guerre contre le terrorisme.
Quelques années après sa mission danoise, Vuk, le tueur serbe,
a refait sa vie aux USA. Il est devenu John Ericsson, guide dans le désert de la Death Valley pour riches touristes en mal de sensations et s'est fondu, avec femme et enfants, dans la banalité du
mode de vie banlieusard américain. Mais le 11/09/2001 fait exploser son tranquille quotidien: toutes les forces de police américaines sont sur le pied de guerre et vérifient la situation des
immigrés sur leur territoire. Vuk/John est arrêté et identifié. Pour le commissaire des services de renseignements de la police danoise Per Toftlund, le 11/09/2001 marque aussi un changement: il
est placé à la tête d'une cellule spéciale des services secrets dont la mission est de collecter des informations sur les réseaux islamistes. Un jour, Per apprend l'arrestation de Vuk et attend
alors avec un sentiment de vengeance son extradition au Danemark. Quelques temps après, c'est de la mort de Vuk -frustrante pour Per- lors d'une tentative d'évasion dont on informe Toftlund. En
réalité, les services secrets américains considèrent Vuk comme très intéressant du fait de sa connaissance des milices islamistes acquise durant la guerre des Balkans et donc comme pouvant
leur être potentiellement -et secrètement- utile. Ainsi, Toftlund et Vuk se retrouvent tous deux impliqués dans la nouvelle guerre contre le terrorisme.
 Je n'aurai pas ici l'outrecuidance de vouloir essayer d'ajouter quelque pauvre analyse de mon cru aux maints
travaux universitaires déjà publiés au sujet du monument littéraire de Melville. (Ni non plus d'en proposer un résumé, tant le livre est connu). Non, mon propos sera autre:
simplement rendre compte de l'enthousiasme suscité en moi par la lecture de cette œuvre vieille de plus de 150 ans et par-là même espérer inciter quelque autre lecteur du XXIème siècle, comme moi
plus familier des polars ou autres romans contemporains, à monter à son tour à bord du Péquod.
Je n'aurai pas ici l'outrecuidance de vouloir essayer d'ajouter quelque pauvre analyse de mon cru aux maints
travaux universitaires déjà publiés au sujet du monument littéraire de Melville. (Ni non plus d'en proposer un résumé, tant le livre est connu). Non, mon propos sera autre:
simplement rendre compte de l'enthousiasme suscité en moi par la lecture de cette œuvre vieille de plus de 150 ans et par-là même espérer inciter quelque autre lecteur du XXIème siècle, comme moi
plus familier des polars ou autres romans contemporains, à monter à son tour à bord du Péquod. Harry Fabian,
costume pied-de-poule ou à fines rayures, chaussures deux tons et fleur à la boutonnière, est un petit magouilleur connu de tout le Londres des bas-fonds, toujours un "grand projet" en
préparation, toujours à la recherche d’argent pour le monter. Harry est rabatteur pour le Renard Argenté, une boite de nuit où chante Mary, sa fiancée. Cette boîte est dirigée par le gros
Phil Nosseross et sa compagne Helen. Une nuit où Harry, à la recherche de gogos à attirer au Renard Argenté, se mêle au public d’un match de catch, il assiste à la colère de Grégorius, un ancien
champion de lutte gréco-romaine outragé par ce spectacle qui déshonore ce noble art. C’est le propre fils de Grégorius, Kristo, un patron de la pègre craint et respecté de tous, qui a le monopole
de l’organisation des combats dans Londres. Harry a l’idée d’un nouveau coup et, profitant de la brouille entre père et fils, il se lie avec Gregorius et lui propose d’organiser des combats
respectueux de la tradition. Pour lancer ce nouveau "big plan", Harry réussit à obtenir de l’argent d’Helen en échange d’une licence qui permettra à celle-ci de quitter Phil, qu’elle méprise, et
d’ouvrir sa propre boite de nuit. Grâce à cette somme de départ, Harry convainc Phil de devenir son associé et de le financer. Harry devient ainsi patron d’une salle de sport et
organisateur des combats du poulain de Grégorius, Nicolas, Kristo ne pouvant rien contre lui tant qu’il est sous la protection de Grégorius. Mais Phil, jaloux, croyant à une histoire entre Helen
et Harry, va chercher à perdre ce dernier. Commence alors la chute de Harry.
Harry Fabian,
costume pied-de-poule ou à fines rayures, chaussures deux tons et fleur à la boutonnière, est un petit magouilleur connu de tout le Londres des bas-fonds, toujours un "grand projet" en
préparation, toujours à la recherche d’argent pour le monter. Harry est rabatteur pour le Renard Argenté, une boite de nuit où chante Mary, sa fiancée. Cette boîte est dirigée par le gros
Phil Nosseross et sa compagne Helen. Une nuit où Harry, à la recherche de gogos à attirer au Renard Argenté, se mêle au public d’un match de catch, il assiste à la colère de Grégorius, un ancien
champion de lutte gréco-romaine outragé par ce spectacle qui déshonore ce noble art. C’est le propre fils de Grégorius, Kristo, un patron de la pègre craint et respecté de tous, qui a le monopole
de l’organisation des combats dans Londres. Harry a l’idée d’un nouveau coup et, profitant de la brouille entre père et fils, il se lie avec Gregorius et lui propose d’organiser des combats
respectueux de la tradition. Pour lancer ce nouveau "big plan", Harry réussit à obtenir de l’argent d’Helen en échange d’une licence qui permettra à celle-ci de quitter Phil, qu’elle méprise, et
d’ouvrir sa propre boite de nuit. Grâce à cette somme de départ, Harry convainc Phil de devenir son associé et de le financer. Harry devient ainsi patron d’une salle de sport et
organisateur des combats du poulain de Grégorius, Nicolas, Kristo ne pouvant rien contre lui tant qu’il est sous la protection de Grégorius. Mais Phil, jaloux, croyant à une histoire entre Helen
et Harry, va chercher à perdre ce dernier. Commence alors la chute de Harry. Malgré les multiples défauts, malgré les bassesses dont se montre capable son personnage,
Widmark nous le rend sympathique, attachant. Car Harry est généreux, exempt de toute méchanceté, de toute volonté de nuire. Harry est un aimable loser pour les autres "forbans de
la nuit" qui le regardent d’un œil plutôt bienveillant et désabusé tout à la fois, voire même presque attendri. Car en réalité, Harry est resté un enfant, comme le dira sa fiancée Mary ; un
enfant dévoré par l’ambition, au besoin de reconnaissance démesuré qui lui donne une inépuisable énergie (voir sa réaction lorsqu’il reçoit la plaque à son nom le désignant comme manager).
Son credo : "I wanna be somebody." Lorsque à la fin du film, Harry, épuisé, vidé, abandonné, cessera enfin de courir, ce sera auprès de la vieille Anna, une trafiquante de cigarettes et
de bas nylon des bords de la Tamise qui, dans un bercement maternel, lui offrira sa dernière cigarette -comme un ultime biberon- tandis que Harry, baissant les bras pour la première fois,
évoquera un bref instant son enfance, posera un dernier regard lucide sur sa vie de perpétuel fuyard de lui-même, dans une séquence où il voit enfin le jour se lever.
Malgré les multiples défauts, malgré les bassesses dont se montre capable son personnage,
Widmark nous le rend sympathique, attachant. Car Harry est généreux, exempt de toute méchanceté, de toute volonté de nuire. Harry est un aimable loser pour les autres "forbans de
la nuit" qui le regardent d’un œil plutôt bienveillant et désabusé tout à la fois, voire même presque attendri. Car en réalité, Harry est resté un enfant, comme le dira sa fiancée Mary ; un
enfant dévoré par l’ambition, au besoin de reconnaissance démesuré qui lui donne une inépuisable énergie (voir sa réaction lorsqu’il reçoit la plaque à son nom le désignant comme manager).
Son credo : "I wanna be somebody." Lorsque à la fin du film, Harry, épuisé, vidé, abandonné, cessera enfin de courir, ce sera auprès de la vieille Anna, une trafiquante de cigarettes et
de bas nylon des bords de la Tamise qui, dans un bercement maternel, lui offrira sa dernière cigarette -comme un ultime biberon- tandis que Harry, baissant les bras pour la première fois,
évoquera un bref instant son enfance, posera un dernier regard lucide sur sa vie de perpétuel fuyard de lui-même, dans une séquence où il voit enfin le jour se lever. Googie Withers est Helen, belle figure de garce
plus dans la tradition du film noir, femme frustrée et revancharde, avide, dirigeant fermement le cheptel féminin du "Renard Argenté".
Googie Withers est Helen, belle figure de garce
plus dans la tradition du film noir, femme frustrée et revancharde, avide, dirigeant fermement le cheptel féminin du "Renard Argenté". Le Destin a jeté
son dévolu sur Harry et scellé son sort, et qu’elle que soit l’énergie avec laquelle il se débattra, rien ne lui fera y échapper à sa fatale issue. Une tragédie ; comme l’est tout très grand
film noir.
Le Destin a jeté
son dévolu sur Harry et scellé son sort, et qu’elle que soit l’énergie avec laquelle il se débattra, rien ne lui fera y échapper à sa fatale issue. Une tragédie ; comme l’est tout très grand
film noir. Spots est un jeune délinquant de Seattle, d'origine mi-irlandaise, mi-indienne, le visage piqué de
boutons d’acné (d’où son surnom), baladé de foyers en maisons d’accueil depuis l’enfance. Un jour, il se lie d’amitié avec Justice, un autre jeune comme lui à la dérive. Ensemble, ils
braquent une banque et Spots prend une balle dans la tête. Avant que son corps ne touche le sol, il part dans un étrange voyage dans le temps et dans l’espace qui lui fera revivre des
moments-clef de l’histoire des indiens d’Amérique et de l’histoire de ses origines familiales.
Spots est un jeune délinquant de Seattle, d'origine mi-irlandaise, mi-indienne, le visage piqué de
boutons d’acné (d’où son surnom), baladé de foyers en maisons d’accueil depuis l’enfance. Un jour, il se lie d’amitié avec Justice, un autre jeune comme lui à la dérive. Ensemble, ils
braquent une banque et Spots prend une balle dans la tête. Avant que son corps ne touche le sol, il part dans un étrange voyage dans le temps et dans l’espace qui lui fera revivre des
moments-clef de l’histoire des indiens d’Amérique et de l’histoire de ses origines familiales. Un couple âgé décide de
s’installer dans un endroit isolé de la campagne anglaise et y fait construire une petite maison. A quelques temps de là, un jeune couple y fait également bâtir sa maison. Les deux couples
voisins se lient d’amitié. Le jeune homme est particulièrement excessif dans ses sentiments et dans leur expression. Un jour, il adopte un chien, Ponto, qu’il se met à vénérer à un point tel que
l’animal devient petit à petit le maître tyrannique de la maison. Mais la jeune femme tombe enceinte et le chien voit, d’un très mauvais œil, l’adulation dont il est l’objet remise en
cause.
Un couple âgé décide de
s’installer dans un endroit isolé de la campagne anglaise et y fait construire une petite maison. A quelques temps de là, un jeune couple y fait également bâtir sa maison. Les deux couples
voisins se lient d’amitié. Le jeune homme est particulièrement excessif dans ses sentiments et dans leur expression. Un jour, il adopte un chien, Ponto, qu’il se met à vénérer à un point tel que
l’animal devient petit à petit le maître tyrannique de la maison. Mais la jeune femme tombe enceinte et le chien voit, d’un très mauvais œil, l’adulation dont il est l’objet remise en
cause.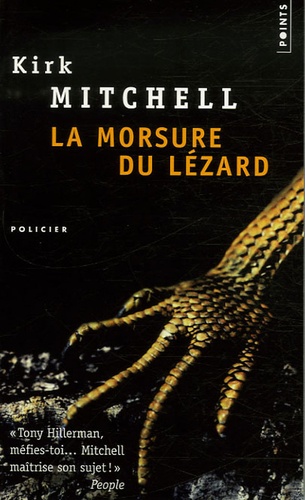 Etats-Unis, Grande Réserve Najavo. A l’arrière d’un véhicule de
police abandonné dans un coin reculé sont retrouvés les cadavres calcinés d’un officier de la police navajo et sa femme. L’enquête sur ce double crime revient à Emmett Parker, un indien
commanche officier du Bureau des Affaires Indiennes et son équipière Anna Tunipseed, indienne modoc agent spécial du FBI. Leurs investigations à travers les paysages désolés des Four Corners vont
les amener sur la piste d’un tueur psychopathe qui se prend pour le dieu Lézard Perlé.
Etats-Unis, Grande Réserve Najavo. A l’arrière d’un véhicule de
police abandonné dans un coin reculé sont retrouvés les cadavres calcinés d’un officier de la police navajo et sa femme. L’enquête sur ce double crime revient à Emmett Parker, un indien
commanche officier du Bureau des Affaires Indiennes et son équipière Anna Tunipseed, indienne modoc agent spécial du FBI. Leurs investigations à travers les paysages désolés des Four Corners vont
les amener sur la piste d’un tueur psychopathe qui se prend pour le dieu Lézard Perlé.